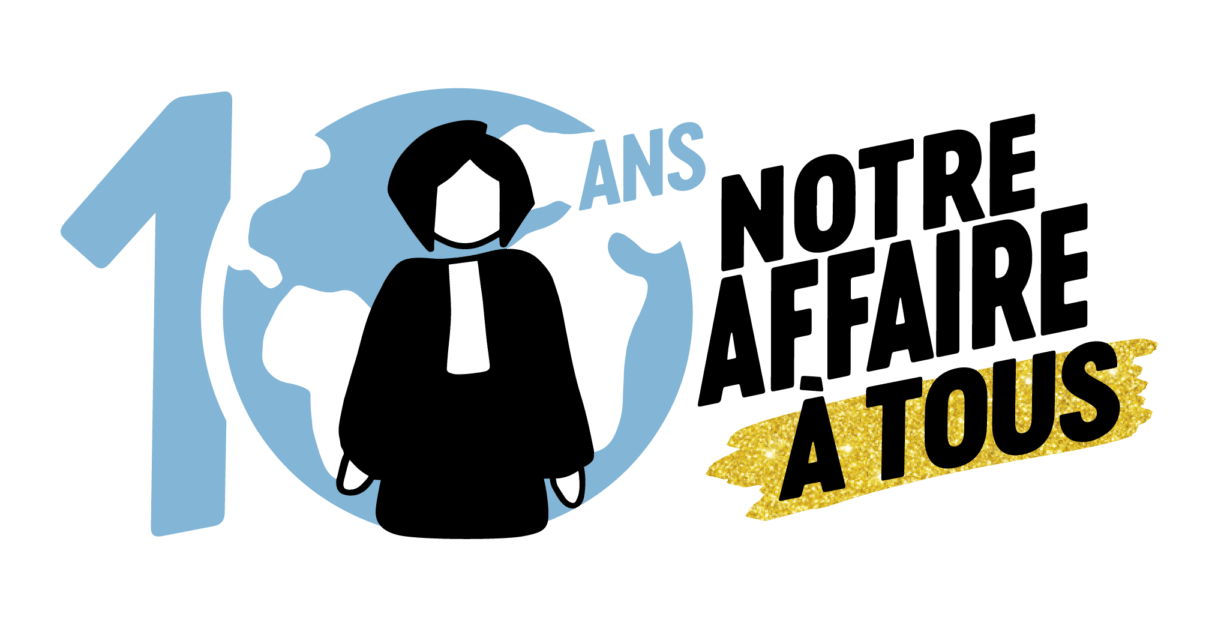Par Olivia Gervais, Chloé Gerbier et Edgar Priour-Martin, membres de Notre Affaire à Tous
La participation du public dans l’aménagement du territoire : un enjeu de démocratie locale majeur
Participation, consultation, concertation, co-construction… De quoi parlons-nous ?
Le principe de participation du public consiste à associer les habitant·e·s, citoyen·ne·s aux processus de décisions en mobilisant ou en impliquant dans la démarche de réflexion ou de construction d’un projet ou d’un programme d’aménagement.
- La consultation : le niveau de base de la participation puisque les citoyen·ne·s sont seulement consulté·e·s sur un projet déjà défini. La décision revient aux décideur·euse·s, non aux consulté·e·s. Elle fait partie de la procédure obligatoire pour les décisions qui ont une incidence directe et significative sur l’environnement.
- La concertation : sur le même principe que la consultation, la décision finale revient aux décideur·euse·s mais le projet cette fois est censé n’être défini que dans ses grands principes. La procédure a donc plus de chances d’enrichir le projet, d’ouvrir le débat, d’être concertée avec les administré·e·s.
- La co-construction : la décision est partagée. La co-construction d’un projet reste à l’initiative des décideur·euse·s, elle n’est pas prévue réglementairement.
Le droit à l’information et le principe de participation procèdent de l’intention de promouvoir une démocratie environnementale. Plus transparente, l’action publique est mieux acceptée et comprise si les citoyen·ne·s ont été consulté·e·s et ont eu en amont la possibilité de faire partie de la prise de décision.
Souvent, contre de nombreux projets inutiles et polluants, les citoyen·ne·s ont beaucoup de choses à dire, iels sont mobilisé·e·s, pensent à l’avenir de leurs enfants, à la qualité de l’air, de la terre, de l’eau qui impacte leur santé. Leur avis compte car ce sont les premier·e·s concerné·e·s et iels peuvent constituer un rempart contre le désastre écologique à venir. Pour cela, les citoyen·ne·s ont besoin de pouvoir s’emparer des outils de la participation, d’avoir accès à la prise de décision, et de pouvoir influencer des documents décisifs comme les plans locaux d’urbanisme (PLU) par exemple.
Il s’agira tout d’abord de passer en revue les droits de participation et d’information tels qu’ils sont consacrés dans les textes de loi, en les comparant à la réalité des enquêtes publiques d’aujourd’hui, et en rappelant le phénomène actuel de détricotage du droit de l’environnement – I. Nous analyserons ensuite la consultation comme une participation en trompe-l’œil – II, avant de proposer une analyse prospective de la participation de demain – III.
I. Les droits à l’information et à la participation du public
A. Des droits garantis aux échelles européenne et nationale
Ces droits sont consacrés à l’échelle européenne, notamment sous l’égide de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation stratégique environnementale en vue de l’évaluation de certaines incidences des plans et programmes (1) sur l’environnement. Mais ces principes sont consacrés de la même façon concernant les projets susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, les installations particulièrement polluantes, les dérogations aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées, etc.
Afin d’entériner l’information et la participation du public, les directives européennes en font une étape-clé du processus décisionnel en matière environnementale.
En droit français, la Charte de l’environnement fait partie de la Constitution française depuis 2005, et reprend aussi dans son article 7 les principes d’information et de participation en affirmant que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
La loi française décline au sein du code de l’environnement ces principes en établissant des procédures d’élaboration des plans et programmes et d’autorisation des projets ayant des incidences sur l’environnement (2).
La première étape de ces procédures est l’évaluation environnementale. Ce processus débute par l’établissement d’une étude d’impact permettant le recensement des enjeux environnementaux liés au projet. Elle permet un éclairage objectif et exhaustif du projet permettant l’information et la participation effectives du public.
L’étude d’impact est ensuite soumise à l’avis de plusieurs personnes publiques associées (notamment des collectivités concernées). Leurs avis sont joints à l’étude d’impact, aboutissant à la composition du dossier d’enquête publique. Ce dossier permet aux citoyen·ne·s de s’informer sur le contenu et les impacts du projet en gestation.
La tenue de cette enquête publique répond à des règles de procédure strictes, en termes de délais et de publicité (annonce à 15 jours du début de l’enquête, pour une durée de 30 jours minimum), autant que de suivi, avec la désignation d’un commissaire-enquêteur qui est chargé du bon déroulé des réunions publiques et de la récolte des avis déposés.
Néanmoins, le juge administratif considère que les insuffisances procédurales portant atteinte au dossier, comme des omissions au sein de l’évaluation environnementale, « ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative » (3).
Par conséquent, les erreurs de l’étude d’impact se rapportant à l’état initial de l’environnement ou aux effets du projet sur celui-ci ne sont sanctionnées qu’à l’aune des principes de participation et d’information du public. Ce dispositif fait de l’enquête publique un outil pivot de la mise en œuvre de projets, plans ou programmes ayant un impact sur l’environnement.
B. La triste réalité des enquêtes publiques
Pourtant, force est de constater que cette forme de participation ne permet pas d’atteindre les objectifs que s’est fixés la loi. Les enquêtes publiques ne permettent pas au public d’accéder aux informations intéressant les projets menaçant l’environnement, ni de participer réellement à la prise de décision concernant les choix d’aménagement du territoire qui y sont liés.
En effet, certaines enquêtes publiques, malgré le fait qu’elles soient mises en œuvre sur les communes concernées par le projet, voient leur taux de participation demeurer très bas. Les registres n’affichent bien souvent que quelques remarques. Les réunions publiques permettant le respect du droit à la participation et l’information des citoyen·ne·s sont donc vidées de leur sens si celles-ci ne trouvent pas preneur.
La publicité de ces enquêtes est pourtant assurée, mais un encart dans un ou deux journaux locaux et l’affichage en mairie ne suffisent pas à transmettre les enjeux liés à ces réunions.
Au-delà de cette publicité légale minimale, la publicité d’un projet est laissée à la main de son·sa promoteur·trice, qui n’a pas intérêt à attirer l’attention sur le volet environnemental de celui-ci. Il se trouve ainsi aussi peu médiatisé que possible.
De la même façon, en dehors de quelques avis légaux c’est bien souvent l’approche du promoteur·trice (qui finance l’étude d’impact) qui est mise en avant lors de ces réunions, et le projet est présenté de manière à emporter le plus d’adhésion.
De la même manière, le niveau de publicité des procédures d’élaboration des plans et programmes d’aménagement varie énormément en fonction des collectivités, et du contenu du document à faire approuver. Si la révision du plan local d’urbanisme de Paris, en vue d’en faire « le premier PLU bioclimatique de France » (4) a fait l’objet d’une large médiatisation (5), ce n’est malheureusement pas le cas de la plupart des procédures menées partout ailleurs.
En l’absence d’information et de publicité, l’enquête publique n’est plus qu’un passage obligé dans une procédure légale, et non un outil de participation.
Quelques collectifs arrivent néanmoins à se saisir de l’enquête publique qui leur permettra de faire valoir lors des réunions un avis dissident et questionner les failles du dossier. Ce moment peut aussi être celui d’une mobilisation massive des citoyen·ne·s se regroupant autour de leur volonté commune de préserver leur droit à un environnement sain. Dans ce cas, des avis défavorables au projet, plan ou programme sont souvent portés à la connaissance du commissaire-enquêteur, qui peut aussi organiser des rendez-vous particuliers avec les collectifs mobilisés. Néanmoins le·la commissaire-enquêteur·rice ne rend que de manière exceptionnelle un avis défavorable à l’issue de l’enquête publique : malgré les remarques ou objections, celui-ci ou celle-ci estime que les réponses du porteur du plan, programme ou projet a pour effet de lever ces réserves dans une grande majorité des cas. Dès lors, l’enquête se conclut sur un avis favorable du ou de la commissaire-enquêteur·rice, parfois avec de simples réserves.
La réforme des enquêtes publiques permettant une option de participation dématérialisée n’a pas suffi à relever les taux réels de participation qui restent plutôt bas.
Malgré sa centralité, le procédé peine donc, d’une part, à fournir des informations complètes et impartiales au citoyen·ne, et d’autre part, à faire état de manière fidèle de son opinion. Dans les faits, information et participation sont donc partiellement mises en œuvre dans le processus.
C. Le détricotage minutieux du droit de l’environnement
Ces enquêtes publiques, malgré une efficacité controversée, restent un formalisme protecteur. Pourtant, elles pâtissent du détricotage continu du droit de l’environnement, notamment pendant la période de pandémie de Covid-19.
En effet, les procédures d’exception sont de plus en plus nombreuses. En avril dernier, un décret a reconnu un pouvoir général de dérogation aux préfet·e·s, notamment en matière environnementale (6). Les préfet·e·s peuvent depuis dispenser certains projets de la procédure de droit commun évoquée ci-dessus, si cette dérogation est « justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales », et qu’elle a « pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques ».
Un décret du 3 juillet poursuit dans ce sens et assure aux préfet·e·s la décision dans les procédures dites de « cas par cas » visant à déterminer si un projet doit se soumettre ou non à une étude d’impact environnemental. Le 17 juillet, la consultation sur les projets de décret et d’arrêté prend fin de manière discrète. Pourtant ces actes apportent une réduction des périmètres de procédure ICPE et de projets soumis à autorisation environnementale, principalement dans le secteur de la logistique.
Traduction dans les faits de cette philosophie, le 20 juillet le gouvernement annonce l’aménagement de 66 nouveaux sites « clé en main », où les procédures administratives ont été effectuées avant la désignation du maître d’ouvrage à l’échelle du site. Pourtant, l’étude d’impact et l’enquête publique sur le site sont effectuées bien en amont de la désignation du maître d’ouvrage et les projets sont à ce moment encore très flous. Les procédures demeurent donc vagues et n’apportent pas de garanties.
D’autre part, la loi ASAP (« loi d’accélération et de simplification de l’action publique ») du 7 décembre 2020 prévoit à son article 44 que le·la préfet·e pourra préférer une consultation électronique à l’enquête publique classique afin d’accélérer la procédure des projets nécessitant une autorisation environnementale.
II. La consultation, participation en trompe-l’oeil
A. L’exemple des consultations en ligne
Ainsi, comme on le voit avec l’exemple de la loi ASAP, la tendance législative est à la multiplication des consultations en ligne. Mais cette forme de participation ne permet ni d’impliquer plus de citoyen·ne·s, ni de faire état de manière fidèle des opinions exprimées.
En effet, les associations et parties prenantes déjà mobilisées sur les questions posées constitueraient l’essentiel des contributeur·trice·s. La consultation n’est pas diffusée, ou presque, en amont et comme le souligne le rapport publié par la commission nationale du débat public, « le choix des dates des consultations est dicté par l’agenda politique ou réglementaire et ce critère n’est pas rendu public » (7).
Le principe même de consultation ne cherche pas à remettre en question la logique verticale de l’administré·e et du décideur·euse puisqu’elle est à l’initiative de celui-ci, qui garde le pouvoir de décision et qui, simplement, consulte. D’ailleurs, dans ce rapport, on peut aussi lire que les décideur·euse·s accordent plus d’importance au comptage des positions plutôt qu’à la compréhension des arguments. La méthode n’est pas de concerter, et encore moins de co-construire, mais plutôt de mieux asseoir la légitimité du représentant·e politique.
L’intérêt d’une consultation n’est donc pas d’écouter les participant·e·s ou de s’intéresser à leurs réponses, mais plutôt d’y rassembler un maximum de participant·e·s, afin de légitimer l’action publique visée.
Enfin, le rapport précité de la CNDP constate la tendance des pouvoirs publics à synthétiser les contributions sans les relier à la décision. En effet, « certaines consultations, notamment locales, comportent des considérants qui ne mentionnent pas les résultats de l’analyse des commentaires, voire pas la consultation elle-même, mais plutôt d’autres éléments de contexte. […] Il n’est pas évident pour le grand public de faire le lien entre sa participation et son influence sur la décision finale puisque même matériellement, ce lien n’est pas établi » (8).
B. L’exemple emblématique de Notre-Dame-des-Landes
Dans certains cas, la consultation est même truquée par les pouvoirs publics qui la mettent en place, puisque orientée par le choix des questions qui sont posées ou même par le périmètre de consultation choisi. En la matière, l’exemple du processus de participation autour du projet de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ayant abouti à un surprenant référendum est emblématique.
En 2015, François Hollande annonçait l’organisation d’un référendum local hors de toute procédure établie pour trancher la question du lancement ou non de l’ancien projet d’aéroport, datant des années 1960, et connaissant une vive et tout aussi ancienne opposition. Le référendum s’est finalement transformé en consultation en raison du flou juridique de la procédure.
Les gouvernements Valls, et Ayrault avant lui, s’étaient prononcés ouvertement pour la construction de l’aéroport. Ces gouvernements, et les précédents, n’avaient pas réussi à passer en force par la police. Ce référendum annoncé était donc le moyen de donner une nouvelle assise légitime à ce projet, en mettant l’opinion publique du côté du gouvernement. Le choix du périmètre de la Loire-Atlantique a été très contesté puisque le projet d’aéroport relevait de l’Etat et qu’il était également financé par les régions voisines. Ensuite, la question qui a été posée (« êtes-vous favorable au transfert ? ») a été considérée dès le départ biaisée par beaucoup d’opposant·e·s au projet puisqu’elle sous-entendait que l’aéroport de Nantes serait fermé alors même qu’il était prévu que cet aéroport serve à Airbus pour des tests d’engins. Par ailleurs, la façon dont ont été menés les rares débats au préalable a été vivement critiquée. Les questions économiques, sociales et écologiques étant évitées, le débat fut vidé de toute substance utile à une prise de décision éclairée.
Malgré le résultat prévisible de la consultation, favorable à la construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD est restée occupée et les travaux n’ont pas commencé. Le nouveau gouvernement promettait de se décider en janvier 2018. Finalement, le projet a été officiellement abandonné le 17 janvier 2018, présenté comme une impasse par les pouvoirs publics, notamment par Edouard Philippe qui réaffirmait que la déclaration d’utilité publique avait été lancée, que les recours avaient été purgés, que la population avait été consultée et que le débat aurait dû être clos, mais en reconnaissant que le « contexte d’opposition exacerbé », a conduit à ce que cet « aéroport de la division » soit finalement abandonné.
Ainsi, on voit bien avec cet exemple que la consultation est parfois instrumentalisée afin de légitimer des décisions déjà prises. Finalement, cet outil initialement présenté comme un moyen de promouvoir une démocratie environnementale peut parfois s’avérer être plutôt un moyen de valider des choix controversés. Éviter ce genre de contournement et assurer le respect du principe de participation du public semble nécessaire pour garantir une démocratie environnementale et participative.
III. Participation de demain, définir ensemble les territoires
L’enjeu du plan local d’urbanisme (intercommunal)
Certaines initiatives citoyennes comme la contribution au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), portée par une association intégrée au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (9), proposent de nouvelles manières d’organiser les plans locaux d’urbanisme. En l’espèce, la contribution (10) proposait de faire apparaître la ZAD comme une zone mixte qui ne rentre pas dans les zones réglementaires traditionnelles (à urbaniser, agricoles, urbaines, …), puisque c’est une terre issue de la lutte sur laquelle s’exercent des activités agricoles mais pas seulement : certain·e·s y vivent sans être agriculteur·trice. Malheureusement, elle n’a pas été prise en compte par les pouvoirs publics.
Les documents d’urbanisme sont établis conformément au code de l’urbanisme, et à l’échelle des collectivités. Le plus courant est le plan local d’urbanisme, pris à l’échelle d’une commune (PLU), ou d’une intercommunalité (PLUi). Il définit sur le territoire des zones et leur affectation à certaines activités (zones agricoles, urbaines, à urbaniser ou naturelles). L’élaboration du PLU ainsi que son adoption est à la charge du conseil municipal ou communautaire.
Au sein du document d’urbanisme se décident d’ores et déjà les futures zones protégées ou urbanisées à l’échelle du territoire. Ce document est soumis aux procédures de participation du public comme susmentionné.
Actuellement, les acteur·trice·s de l’environnement se mobilisent (parfois) au moment de l’adoption du plan local d’urbanisme, néanmoins iels peinent à se faire entendre et à mobiliser autour de ce sujet. De plus, hors de ces périodes d’adoption du PLU, ces acteur·trice·s utilisent peu cet outil comme moyen de transformation et de protection de l’environnement direct, alors que ces documents peuvent être révisés à tout moment.
Les plans locaux d’urbanisme, en ce qu’ils influent directement sur notre vie quotidienne, devraient faire l’objet d’une plus grande publicité, les citoyen·ne·s devraient donc être davantage informé·e·s des conséquences de ceux-ci sur leur vie quotidienne.
Réduire la complexité au niveau de ces documents reviendrait à enseigner largement leur utilité et leur mode de fonctionnement aux citoyen·ne·s. En effet, l’action des collectivités en matière d’aménagement du territoire, régie à l’article L101-2 du code de l’urbanisme, doit être dirigée afin de poursuivre les objectifs de développement durable, notamment en protégeant les milieux naturels et en luttant contre le changement climatique.
Pourtant, nombre de collectivités ne poursuivent pas ces objectifs en continuant d’urbaniser massivement au détriment de leur population.
Les citoyen·ne·s peu averti·e·s ne peuvent se saisir de ces outils. Une meilleure connaissance des enjeux permettrait une participation plus effective autour des phases d’élaboration du plan. Une personne d’ores et déjà engagée aura à ce moment-là l’opportunité d’allier un plus grand nombre à sa cause et d’intéresser par les intérêts individuels à une plus grande protection de l’environnement. Si cette solution n’est pas la panacée elle permet néanmoins des garde-fous, puisqu’en alliant une majeure partie de la population à la participation, dans le cas où la décision en serait déconnectée, la population participante accepterait mal la décision finale.
Les propositions émises de manière éclairée au vu des différents intérêts en présence devraient être prises en compte, et pourraient aboutir au choix le plus bénéfique pour l’environnement. La seule manière de faire que la décision se porte sur ce choix est de responsabiliser les citoyen·ne·s participant·e·s, et de reconnaître qu’en faisant un choix à haute visée environnementale iels ont conscience des conséquences possibles de celui-ci sur d’autres intérêts et éventuellement sur leurs libertés individuelles. Pour cela une transparence sur les enjeux et une ouverture complète des problématiques propres au territoire est nécessaire.
Si dans un premier temps elle n’est pas légalement contraignante, la participation deviendrait néanmoins liante en termes d’acceptabilité. De plus, dans une logique électoraliste, elle pousserait les instances décisionnaires à s’aligner sur la volonté commune ou du moins à ne pas trop s’en écarter.
Il s’agirait donc dans notre exemple du PLU : d’éclairer ses enjeux, de les exposer le plus largement possible, afin de permettre aux citoyen·ne·s d’établir leur propre balance vis-à-vis de ces enjeux, et de permettre une décision en lien avec ceux-ci.
B. Propositions pour le droit de la participation du public de demain
A propos des pistes législatives qui permettraient cette participation accrue, nous pouvons penser notamment à l’instauration d’un seuil de participation minimale de la population lors de l’élaboration des documents d’urbanisme. En effet, un tel seuil pousserait les collectivités locales à user d’une plus grande pédagogie et de publicités autour de l’élaboration des documents afin d’obtenir l’intérêt des citoyen·ne·s du territoire concerné.
D’autre part, instaurer un référendum local lors de l’ouverture d’une zone à l’urbanisation peut être une manière d’évaluer si cette urbanisation répond réellement à l’utilité publique locale. Par exemple, lors de l’ouverture d’une zone d’aménagement concerté, celle-ci est amorcée sous l’égide de l’intérêt public du territoire, ce qui sous-entend que le territoire manque d’un aménagement. Afin de déterminer si ce besoin est réel ou s’il répond à des intérêts privés et des motivations simplement économiques, la meilleure solution semble être de demander aux citoyen·ne·s leur opinion.
Enfin, instaurer des conseils citoyens à l’échelle des établissements publics de coopération internationale (EPCI), des départements ou des régions, sur le modèle de la Convention Citoyenne pour le Climat, pourrait être un moyen de hiérarchiser les projets et les axes d’aménagement du territoire selon une volonté désintéressée. Ces démarches existent déjà sur des sujets très concrets comme l’aménagement d’un littoral submersible en Normandie ou de certains centre-villes à redynamiser. Néanmoins, ici, tout l’enjeu serait de traiter les politiques publiques du territoire de manière plus globale.
Toutefois, la mise en place d’une telle institution n’aurait de sens que si celle-ci est dotée d’un véritable pouvoir d’initiative et de décision, ou tout du moins de blocage de la décision politique. A cet effet, notons que les grandes intercommunalités ont déjà l’obligation, depuis 2015, d’instituer un conseil de développement, censé représenter les « milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs » et être consultés « sur l’élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l’évaluation des politiques locales de promotion du développement durable » (11).
Mais qui a déjà entendu parler de ces institutions ? Si certaines agglomérations se sont saisies de cet outil (12), d’autres l’ont laissé à l’état de coquille vide, ne respectant pas l’obligation minimale de consultation fixée par la loi (13). Preuve de l’échec de cette instance : si en 2015, la loi imposait à toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitant·e·s de s’en doter, elle a relevé ce seuil à 50 000 habitant·e·s en 2019, le rendant facultatif en-dessous de ce seuil.
Conclusion ― L’émergence d’un débat public éclairé
Les outils démocratiques existent donc déjà pour une large part. Il convient désormais que les citoyen·ne·s et les collectivités, par le biais de leurs assemblées élues, s’en emparent.
L’exemple de la Convention Citoyenne pour le Climat a démontré que le processus de décision s’inscrit nécessairement dans un temps long, qui permet à chacun·e de prendre connaissance et de débattre du sujet abordé. Même dans un format accéléré (sept week-ends de réunions seulement), la Convention aura nécessité six mois pour formuler ses 149 propositions.
Mais les processus de participation resteront lettre morte s’ils ne s’incorporent pas aux processus de décision. La Convention Citoyenne pour le Climat n’aura été qu’une expérience sociale, et non un réel moment démocratique, si ses propositions ne sont pas reprises (ou au moins étudiées) par le Parlement et l’exécutif.
De la même manière, les mécanismes d’association des habitant·e·s aux décisions intéressant l’aménagement du territoire où ils et elles vivent ne seront réellement démocratiques que lorsqu’ils permettront de faire émerger un débat citoyen éclairé, que la décision politique devra réellement prendre en compte.
Notes
- Ces plans et programmes sont des documents réglementaires de planification encadrant les projets d’aménagement (publics et privés) sur un territoire donné.
- Articles L123-1 et R123-1 et suivants du code de l’environnement.
- Conseil d’Etat, 14 octobre 2011, n°323257 ; Conseil d’Etat, 15 mai 2013, n°353010.
- Dorothée Laperche, Actu Environnement, Révision du plan local d’urbanisme, Paris a consulté les habitants, 12 novembre 2020.
- Emeline Cazi, Le Monde, Plus de végétalisation et de concertation… Paris veut adapter son plan local d’urbanisme à l’urgence climatique, 23 juillet 2020.
- Décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.
- Mélanie Goffi, Commission nationale du débat public, Avis sur les consultations en ligne, 19 décembre 2019, page 16.
- Mélanie Goffi, Commission nationale du débat public, op. cit., page 23.
- L’association pour un Avenir commun dans le Bocage à la construction d’un projet de territoire post-aéroport du Grand Ouest (AACB) : https://zad.nadir.org/
- Tiens voilà le PLUi ! Contribution au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal pour l’avenir de la ZAD – Zone A Défendre, 11 octobre 2018.
- Article L5211-10-1 du code général des collectivités territoriales.
- Par exemple, Tours Métropole Val de Loire : https://codev.tours-metropole.fr/
- Par exemple, le Conseil de développement de Caen Normandie Métropole n’a plus d’activité depuis 2014: http://www.caen-metropole.fr/tags/conseil-developpement