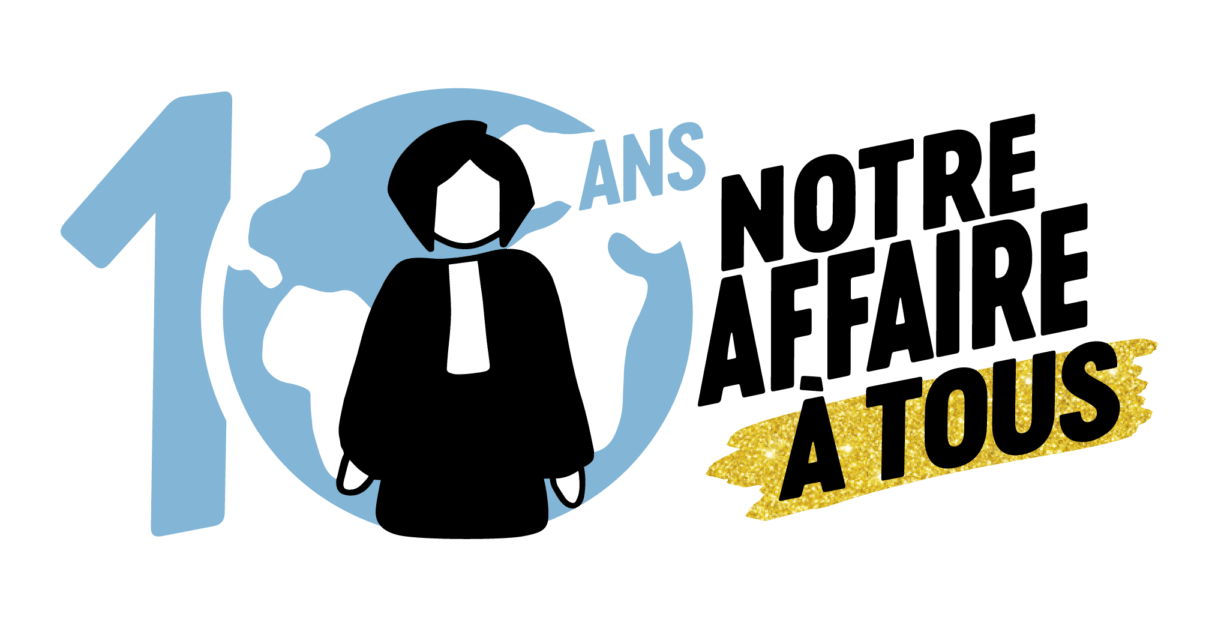NOS DERNIÈRES ACTUALITÉS
The Case of the Century: Chronology of the legal action
Why turn to the courts? State inaction is illegal! The state is obliged to respect its national, European and international commitments and to protect its citizens’ human rights. The victims of climate change are now visible. Citizens have clearly understood the widening gap between words and deeds, and that nothing is really being done today to counter the current climate crisis. All means of action have been used: individual actions, citizen mobilizations, boycotts as well as non-violent resistance. But neither the big polluters nor the States have answered the citizens and scientists calls for climate action. Today, France is not keeping its commitments, even those it has set itself. December 18, 2018: launch of the Case of the Century On 18 December 2018, Notre Affaire à Tous, in partnership with the Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France and Oxfam France, initiated « l’Affaire du Siècle », the climate litigation case against the French State. The aim of this case is to have the judge recognise the general obligation of the French State to act in the fight against climate change, in order to protect French citizens’ rights against the dangerous impacts of climate change. The petition of support was signed by more than 2 million people in just a few weeks. March 14, 2019: filing of the summary request at the Administrative Court of Paris On February 15, 2019, the Minister of the Ecological and Solidary Transition rejected the request of NGOs Notre Affaire à Tous, Greenpeace France, Oxfam France and the Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme. They were seeking, on the one hand, to get compensation for the damages suffered as a result of the State’s faults in the fight against climate change and, on the other hand, to urge the State to put an end to all of its failures concerning climate issues. On Thursday, March 14, 2019, they filed their lawsuit tackling the State’s inaction over climate change via a « summary request » before the Administrative Court of Paris. May 20, 2019: Filing of the additional brief to the Court Following the summary request filed for the Case of the Century before the Paris Administrative Court on March 14, the lawyers of Notre Affaire à Tous, the Nicolas Hulot Foundation for Nature and Mankind, Greenpeace France and Oxfam France filed an additional brief detailing all the arguments of the climate litigation case against the French State for climate inaction. This filing officially launched the beginning of the trial period. June 24, 2020: The State files its reply Nearly sixteen months after the start of the case, the State finally responds to the arguments filed against it by Notre Affaire à Tous, the Nicolas Hulot Foundation, Greenpeace France and Oxfam France, for the Case of the Century. In its 18-page defense brief, the State rejects the arguments presented by the co-plaintiff organizations and denies the deficiencies pointed out, even though they had, in the meantime, been confirmed by the French High Council for the Climate. This response comes at a time when two other organizations – the Fondation Abbé Pierre and the Fédération Nationale d’Agriculture Biologique – are presenting their arguments in support of the Case of the Century to the court. September 4, 2020: The Case of the Century files its reply to the State’s arguments Our lawyers filed our « reply brief » (i.e. our counter-arguments) on September 4, 2020 and 100 testimonies from the « Climate Witnesses » platform launched by the Case of the Century in December 2019. In the reply brief, we remind the court that the responsibility of the State is indeed engaged, by demonstrating that it failed to establish an effective legal framework, and to implement the human and financial means to ensure its respect. The State has a crucial role to play, as regulator, investor and catalyst at all levels. The Case of the Century also demonstrates that by failing to meet its targets for reducing greenhouse gas emissions, energy efficiency and renewable energies, it has itself directly contributed to the climate crisis: between 2015 and 2019, France emitted approximately 89 million tons of CO2 equivalent in excess of its targets – the equivalent of two and a half months of emissions for the entire country (at the pre-covid rate). January 14, 2021: Hearing of the Case of the Century The hearing of the Case of the Century will take place before the Paris Administrative Court on January 14, 2021 at 1:45 pm, more than two years after the launch of this unprecedented legal action against the State’s climate inaction. At the hearing on Thursday, the public rapporteur will present his conclusions, i.e., the decision he recommends the court to take. The lawyers of the Case of the Century, who have demonstrated the State’s faults, will then take the floor to recall our arguments : The State has an obligation to protect us in the face of the climate crisis, yet it is far from respecting its commitments: France has systematically exceeded the carbon ceilings it had set for itself; The target of 23% renewable energy in 2020 is not respected; The delay in the energy renovation of buildings is such that the pace should be multiplied by 10 by 2030; Greenhouse gas emissions in the transport sector have fallen by only 1.5%, whereas the target was -15%! The State, as a defendant, is then also supposed to take the floor. It is not supposed to develop new arguments. The Court is expected to render its decision about two weeks after the hearing, at the end of January.
L’Objectif à valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement dans la jurisprudence du Conseil Constitutionnel
Par Juliette Sardet, membre de Notre Affaire à Tous Lire l’article au format PDF La décision Loi sur la communication audiovisuelle du Conseil Constitutionnel a introduit la notion d’objectif à valeur constitutionnelle (OVC) en 1982 (1). Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel y entendait « la sauvegarde de l’ordre public, le respect de la liberté d’autrui et la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression socio-culturels ». Plusieurs décisions sont venues préciser le contenu, augmenter le champ ou exposer les conséquences de cette notion. L’octroi de ce statut a pour fondement le fait de mettre en œuvre des principes issus du bloc de constitutionnalité. Les OVC ne créent pas de droits mais constituent des buts à atteindre. Ils se traduisent par une obligation de moyen. Ce sont de précieux outils pour le législateur afin de justifier des dérogations limitées à des exigences constitutionnelles et surtout de les concilier entre elles. Le 31 janvier 2020, dans le cadre d’un contentieux relatif à des textes interdisant la production, le stockage et la circulation en France des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées par l’Union européenne, le Conseil Constitutionnel est venu confirmer et étendre le champ des OVC. Par la décision n° 2019-823 QPC, il reconnaît pour la première fois qu’il découle de la Charte de l’environnement de 2004, non plus un « objectif d’intérêt général », mais un « objectif à valeur constitutionnelle deprotection de l’environnement, patrimoine commun des êtres humains » (cons. 4). Il réaffirme également la protection de la santé en tant qu’objectif à valeur constitutionnelle (cons. 5). Ainsi, si le législateur se voit confirmer la possibilité de porter atteinte à d’autres exigences constitutionnelles au nom de la santé publique, il se voit surtout nouvellement habilité au nom de la protection de l’environnement. Cet article se limitera ainsi à traiter ces deux protections en tant que justifications à des atteintes et non en tant que droits pouvant également être violés. La consécration, en tant qu’OVC, de la protection de la santé publique dans les années 1990 et de l’environnement en 2020, est le fruit d’une évolution jurisprudentielle propre à chaque enjeu (I). Si ce sceau constitutionnel peut apparaître symbolique au regard des conséquences qu’induit la qualification d’OVC, cette décision constitue une étape essentielle dans l’applicabilité des normes en matière d’environnement par le législateur et à travers de futurs contentieux environnementaux et climatiques (II). I. Mise en perspective : l’évolution de la santé publique et de la protection de l’environnement dans la jurisprudence constitutionnelle La position du Conseil Constitutionnel vis-à-vis de la protection de la santé et de l’environnement a évolué au fil de l’évolution d’une société de plus en plus soucieuse des enjeux sanitaires et environnementaux. Le contentieux le plus instructif est celui visant à concilier ces enjeux avec la liberté d’entreprendre – reconnue comme une liberté constitutionnelle découlant de l’article 4 de la DDHC (2). Toute limitation de la liberté d’entreprendre doit être justifiée par une exigence constitutionnelle ou un motif d’intérêt général, à condition que l’atteinte ne soit pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi (3). A. Reconnaissance de la santé publique en tant d’OVC Dès les années 1980, découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (4), la santé publique est reconnue comme une exigence constitutionnelle justifiant des limitations par le législateur. Dans un premier temps, le Conseil Constitutionnel lui accorde une « valeur constitutionnelle » dans la décision n° 93-325 DC du 13 août 1993 relative à la loi de la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de séjour des étrangers en France. Afin de justifier des atteintes à la liberté d’entreprendre, la santé publique sera ensuite érigée en « principe constitutionnel » avec la décision de principe n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 (5), rendue sur la loi relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme. Dans un second temps, alors que la santé publique fut de plus en plus mobilisée par le législateur, le Conseil Constitutionnel fut amené à qualifier la santé publique « d’objectif à valeur constitutionnelle » afin de faciliter la conciliation de ces deux exigences. Ce fut le cas des décisions relatives à l’accès aux origines personnelles (6), à la peine complémentaire obligatoire de fermeture de débit de boissons (7), au bisphénol A (8) et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes (9). La légitimité et l’autorité de la protection de la santé publique se sont progressivement assises. Sans qu’il apparaisse que le juge constitutionnel veuille remettre en cause cette qualification d’OVC, il s’est parfois contenté de citer cette exigence constitutionnelle sans pour autant la qualifier d’OVC. Il se limitait à évoquer « la protection de la santé », les « exigences de valeurs constitutionnelles » ou « du onzième alinéa ». Ce fut le cas dans les décisions relatives aux conditions d’exercice de certaines activités artisanales (10), au droit de consommation du tabac dans les DOM (11), à la loi de modernisation de notre système de santé (12), à la publicité en faveur des officines de pharmacie (13), à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (14) et à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (15). B. Consécration tardive mais historique de la protection de l’environnement en tant qu’OVC La reconnaissance du caractère prioritaire de la protection de l’environnement a fait l’objet d’une évolution beaucoup plus prudente. Jusqu’à la décision de janvier 2020, la protection de l’environnement ne fut envisagée que sous l’angle d’un « objectif d’intérêt général » (OIG). Ce dernier constitue également une justification pour porter atteinte à des exigences constitutionnelles, mais ne découle pas du bloc de constitutionnalité. Dans l’équilibre entre différentes normes constitutionnelles, l’OIG pèse relativement moins qu’un OVC face à d’autres exigences constitutionnelles, telles que la liberté d’entreprendre. D’une manière implicite dans un premier temps, dans la décision n° 2016-605 QPC du 17 janvier 2017, relatif à la Confédération française du commerce de gros et du commerce international, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur « a ainsi poursuivi un objectif d’intérêt général ». De façon explicite cette fois, dans la décision Société Schuepbach …
Éthique environnementale et droits : réflexions autour d’une évolution de la perception du droit
Par Xavier Idziak, membre de Notre Affaire à Tous Au-delà d’une rigidité souvent contestée, le droit de l’environnement s’entoure parfois de concepts et de notions plus philosophiques recherchant à répondre à des finalités spécifiques. Les éthiques environnementales proposent une vision de la perception de l’Homme au regard de son environnement, le droit considéré comme un droit de raison cherche à y répondre et à s’inscrire dans les courants des trois éthiques environnementales. Le droit de l’environnement invite régulièrement au travers de l’évolution des enjeux sociaux et environnementaux à repenser la place de l’Homme au sein de l’environnement. Aussi, ce droit et sa construction ont été largement influencés par des notions, concepts et principes ayant favorisé sa construction depuis les années 1960, le droit existant auparavant ne répondant pas à la même logique (1). Ce dernier a été fortement influencé par plusieurs mouvements issus de l’éthique environnementale résultant bien souvent de courants philosophiques cherchant à percer l’armure difficilement perméable du droit. L’éthique environnementale peut être considérée comme « une réflexion philosophique qui a su associer les questions morales classiques (qu’est-ce que la valeur ? comment distinguer le bien et le mal ? le pluralisme est-il nécessaire ?) et les problèmes contemporains qui font de la nature l’objet d’un débat philosophique » (2). Ces courants transcrivent à la fois l’évolution des enjeux sociaux, et aussi de la perception de l’Homme à son environnement naturel (3). L’actualité juridique récente en matière de droit de la Nature (4) invite à s’interroger sur la hiérarchie Homme-environnement. Une présentation successive de ces éthiques permettra de mieux percevoir le carcan juridique entourant le droit de l’environnement et sa perception de la nature. Il sera dès lors procédé à une analyse synthétique de l’anthropocentrisme, du biocentrisme et de l’écocentrisme. Le choix du synthétique ne doit pas être apparenté à l’absence de volonté démonstrative ; elle se fait au contraire dans une volonté pédagogique visant à présenter simplement les courants de l’éthique environnementale sans prendre un parti pris. Le premier des courants de l’éthique environnementale correspond à l’anthropocentrisme. Le droit de l’environnement n’échappe pas au classicisme juridique qui fait que le droit reste, en tout et pour tout, un instrument de domination de l’Humain sur ce qui l’environne (5). Le droit est dans ce contexte généralement conçu de façon à être anthropocentrique, cela signifie que l’Homme reste au cœur des préoccupations, et il n’a qu’une vision utilitariste de la nature (6). Le droit reste « binaire » (7) en incluant l’Homme d’une part et des choses d’autre part ; les Hommes sont « maîtres et possesseurs de la nature » (8). La vision anthropocentrée induit un vocable qui place dans un rapport hiérarchique l’Homme au-dessus de la nature (9). Les éléments de l’environnement sont dans cette éthique, qui reste souvent d’actualité, régis par des définitions donnant un rapport de force permettant d’utiliser librement et sans considération morale. L’environnement n’est dans ce cas perçu que comme une ressource ayant essentiellement une valeur marchande (10). La relation avec l’environnement et ses composantes existe bien, mais l’aspect mercantile et utilitariste prend le pas sur la protection de l’environnement. Si cette protection par le droit existe dans ce courant, elle ne s’organise qu’autour de l’intérêt Humain. L’environnement n’est protégé que lorsque le péril à son encontre affecte directement et durablement l’Homme (11). Pour ce faire, nous utiliserons une série d’exemples. Historiquement, les textes perçoivent l’environnement sous l’aspect d’une propriété où un droit d’usage est souvent conféré (12). Aussi, la Charte de l’environnement vectrice de lourds débats doctrinaux (13) est toujours perçue comme anthropocentrée ; l’environnement étant « le patrimoine commun des êtres humains » (14). Le professeur Fombaustier rappelle à juste titre que dans la Charte « ce n’est donc pas l’homme qui est pour l’environnement, mais bien l’environnement qui est pour l’homme » (15). À ce titre, si l’on s’en tient à réduire la nature ou l’environnement à une simple désignation de composantes, le Code de l’environnement est d’ailleurs particulièrement révélateur de cette vision. Celui-ci dénomme en effet largement l’environnement sous des composantes de ressources naturelles (16), faunistiques (17), génétiques (18) et même marines (19). Le recensement de ces éléments pourrait être opéré sur d’autres points, mais il ne convient pas au travers de ce billet de blog de développer davantage ce point. En droit international, l’environnement est reconnu comme assurant un bienfait à l’Humain. Ainsi, la très célèbre Déclaration de Stockholm de 1972 énonce en son préambule que « l’homme est à la fois créature et créateur de son environnement, qui assure sa subsistance physique et lui offre la possibilité d’un développement intellectuel, moral, social et spirituel. Dans la longue et laborieuse évolution de la race humaine sur la terre, le moment est venu où, grâce aux progrès toujours plus rapides de la science et de la technique, l’Homme a acquis le pouvoir de transformer son environnement d’innombrables manières et à une échelle sans précédent. Les deux éléments de son environnement, l’élément naturel et celui qu’il a lui-même créé, sont indispensables à son bien-être et à la pleine jouissance de ses droits fondamentaux, y compris le droit à la vie même » (20). La dimension anthropocentrée ressort particulièrement de la Convention par un intérêt qui est celui de l’Humanité (21). Au travers de ces exemples, il est possible de constater l’utilitarisme omniprésent de la nature en tant que ressource. La nature n’a pas de valeur intrinsèque dans le courant anthropocentrique (22). Pour autant, d’autres éthiques environnementales prennent en considération la valeur intrinsèque de l’environnement et de la nature et tendent à accorder une meilleure protection juridique. Le biocentrisme, s’il n’est pas à contre-courant de l’anthropocentrisme, propose de revisiter la valeur accordée à l’environnement. Cette conception récente, issue de la philosophie, longuement défendue outre-Atlantique (23), fait preuve d’une perception intrinsèque donnant à l’environnement une fin en soi (24). La présente éthique accorde à l’ensemble des êtres vivants une considération morale (25). Le biocentrisme en rompant avec la vision Kantienne du droit, n’accorde plus uniquement une valeur à l’être humain, il considère l’Humain et l’environnement comme une multitude par le respect de la valeur intrinsèque (26). Cette …
La confrontation des droits de la nature et des droits humains
Par Amina Medgoud, membre de Notre Affaire à Tous Introduction « Our challenge is to create a new language, even a new sense of what it is to be human. It is to transcend not only national limitations, but even our species isolation, to enter into the larger community of living species. This brings about a completely new sense of reality and value » (1) Reconnaître des droits à la Nature interroge notre rapport au monde. En effet, l’Homme moderne occidental, « maître et possesseur de la nature » (2) l’apprivoise et la soumet pour l’exploiter. A cet état de fait, le droit de l’environnement oppose une autre vision du rapport de l’Homme à la Nature qui permet de corriger les abus de son exploitation par des garanties et protections. En France, l’intégration de la Charte de l’environnement dans le bloc de constitutionnalité en 2004 (3) et la création du préjudice écologique dans le Code civil (4) reflètent cette « préoccupation environnementale ». Par ailleurs, la qualification juridique des biens environnementaux (5) nourrit les réflexions doctrinales. Objet extérieur aux personnes (6), les entités naturelles ne sont pas non plus des choses (7). Leur qualification semble donc changer selon la façon dont l’Homme souhaite en disposer. S’il peut exercer son droit de propriété sur certaines choses, il en va différemment lorsque ces entités sont « protégées » par le droit de l’environnement. Dans la perspective française, les « biens communs » bénéficient ainsi d’une protection disparate, non unifiée. Ils ne sont qu’une partie d’un tout, jamais envisagés en tant que détenteurs de droits liés à leur valeur intrinsèque (8). Pourtant, le dérèglement climatique, les catastrophes environnementales répétées, les conséquences manifestes de la surproduction et la surconsommation sont autant de signaux qui incitent à repenser cette construction juridique anthropo-centrée. Aussi, l’émergence de droits de la nature compris comme un « ensemble de règles reconnaissant et protégeant, au titre leur valeur intrinsèque, les entités naturelles et écosystèmes en tant que membres interdépendants de la communauté indivisible de la vie » (9) révèle-t-elle ce changement de paradigme. Ainsi, il ne s’agit plus de considérer la Nature comme objet mais bien comme sujet de droit autonome, au-delà de ce que permet aujourd’hui le droit de l’environnement. Cette modification radicale de notre relation au monde sape la conception jusnaturaliste du droit qui sacralise l’universalité et l’inaliénabilité des droits humains. En effet, les droits humains sont des droits naturels qui font de l’Homme le fondement et le sujet primordial de notre système de droits et de garanties des droits. Cet édifice juridique ne peut être détaché d’une certaine dimension politique et économique des rapports de l’Homme en société et dans son environnement. La confrontation entre ce bloc de droits et celui des droits de la nature apparaît alors pour certains comme le résultat inéluctable d’un rééquilibrage nécessaire afin de mieux protéger l’Homme et son environnement. Pour d’autres, a contrario, elle porte en elle les germes d’une dangereuse déconstruction juridique qui pourrait aboutir à créer « des droits sans l’homme » (10). Si la création de droits de la nature semble induire le glissement d’un système juridique anthropo-centré au profit d’un droit bio-centré (I), ce changement de paradigme n’implique pas nécessairement une incompatibilité entre droits humains et droits de la nature (II). Droits de la nature et droits humains : passage d’un droit anthropo-centré à un droit bio-centré Les premières mentions du droit de la nature apparaissent dans l’ouvrage de Christopher Stone en 1972, « Should trees have standing ? » (11). D’autres auteurs, à l’instar de Thomas Berry, contribuent à conceptualiser une théorie « écologique » du droit dont la portée remet en cause la légitimité de notre système juridique anthropo-centré qui assujettit la planète à l’économie (12). Cette théorie juridique se nourrit, en premier lieu, des idées de communauté et de renforcement mutuel (« mutual-enhancement ») qui fondent la Jurisprudence de la Terre (« Earth Jurisprudence ») : « The basic orientation of the common law tradition is toward personal rights and toward the natural world as existing for human use. There is no provision for recognition of nonhuman beings as subjects having legal rights … the naive assumption that the natural world exists solely to be possessed and used by humans for their unlimited advantage cannot be accepted … To achieve a viable human-Earth community, a new legal system must take as its primary task to articulate the conditions for the integral functioning of the Earth process, with special reference to a mutually enhancing human-Earth relationship » (13) En ce sens, la « communauté de la Terre » est un prérequis à l’existence humaine qui hisse la loi primordiale, « Great law », au rang des droits naturels (14). Cette idée prend corps à travers la définition de la loi primordiale que donne Cormac Cullinan, c’est-à-dire un ensemble de droits ou principes qui gouvernent le fonctionnement de l’univers (15). La Jurisprudence de la Terre assimile les droits de la nature à des droits naturels et, ce faisant, admet la diversité et l’entièreté de la nature et reconnaît sa valeur intrinsèque et immuable. Ainsi, selon Thomas Berry, la Jurisprudence de la Terre reposent sur plusieurs principes fondamentaux : la valeur intrinsèque de toutes les composantes du vivant ; la reconnaissance des caractères primordial et premier des droits de la nature ; l’indivisibilité de la nature, chaque entité du vivant appartenant à un tout interdépendant, l’Homme y compris (16). Cette conception renverse la théorie des droits de l’Homme. En effet, le caractère fondamental des droits de l’Homme repose sur le principe de la dignité humaine. Le préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée le 10 décembre 1948 traduit cette idée : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde » (17). Par ailleurs, en droit français, l’article 16 du Code civil dispose : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de …
L’application du « droit à un environnement sain » par la CJUE : une stratégie cohérente à amplifier
Par James Corne, membre de Notre Affaire à Tous PARTIE I Résumé Cet article ne vise pas, à travers la notion indéterminée de « droit à un environnement sain », un champ du droit de l’Union, à savoir le droit environnemental de l’Union. Il n’étudiera donc ni l’ensemble, ni une partie du droit dérivé. Il comprend cette notion comme un possible principe, de valeur constitutionnelle, permettant de contrôler l’ensemble des actes des institutions et des États membres. Dans un premier temps, il est question de savoir si un tel principe existe. La réponse est loin d’être claire. Il est néanmoins possible de répondre positivement, bien qu’il faille aussitôt ajouter que sa force normative est extrêmement faible. Dans un second temps, il est question de savoir si la CJUE n’a pas cherché à mettre en œuvre une stratégie qui permettrait de dépasser les faiblesses de ce principe. Autrement dit, dans l’impossibilité de l’invoquer efficacement de façon directe, n’est-il pas possible de l’invoquer de façon indirecte ? Il est finalement question, dans l’ensemble de cet article, de la manière dont la Cour met en œuvre le droit à un environnement sain : en ne le reconnaissant pas directement comme un véritable principe de droit, mais en lui garantissant indirectement une certaine effectivité. Il s’agit donc de rechercher, au travers d’arrêts variés et disparates de la Cour, cette stratégie. Pour un résumé plus précis, voir les derniers alinéas, en italique, de cette introduction La première partie de cet article est à lire ci-dessous. Elle concerne l’absence d’un principe, doté d’une véritable force normative, en droit de l’Union garantissant un droit à un environnement sain : un droit en manque de principes. Une seconde partie paraîtra dans le prochain numéro de la newsletter des affaires climatiques de Notre Affaire à Tous, en février 2021. Elle concerne la manière dont la CJUE cherche néanmoins, de façon indirecte, à garantir l’application de ce principe sans réelle force juridique : un principe en manque de droit. Lire l’article en PDF Introduction L’un des objectifs de l’Union est de garantir « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement » (article 3, §3, TUE) (1). En outre, « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et actions de l’Union, en particulier afin de promouvoir le développement durable » (article 11 TFUE) (2). La politique de protection de l’environnement de l’Union est constituée aujourd’hui d’un droit dérivé foisonnant (3). Afin de mettre en œuvre cette politique de protection de l’environnement, l’Union dispose d’une compétence partagée (4) avec les Etats membres (article 4, §2, e) TFUE). Le législateur, statuant conformément à la procédure législative ordinaire (5), décide « des actions à entreprendre par l’Union en vue de réaliser les objectifs visés à l’article 191 » (article 192, §2, TFUE). L’Union étant une organisation internationale, elle ne peut agir que sur le fondement d’une compétence et seulement pour mettre en œuvre les objectifs qui lui sont assignés. Concernant le domaine en cause, ces objectifs sont « la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement », « la protection de la santé des personnes », « l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles » ainsi que « la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l’environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique. » La base juridique définie par l’article 192 TFUE a permis l’adoption d’instruments variés et importants, obligeant, pour ne citer que quelques exemples, les États membres à procéder à des analyses d’impact avant l’adoption de mesures pouvant affecter l’environnement (6), ou, mettant en place le réseau « Natura 2000 » (7), ou, garantissant l’accès à l’information en matière environnementale (8), ou, établissant un label écologique (9), ou, concernant la responsabilité environnementale (10) ou la réduction des émissions polluantes (11). Des mesures garantissant plus indirectement la protection de l’environnement peuvent aussi être adoptées sur le fondement d’autres bases juridiques, telles que celles concernant la santé publique. Si, en principe, l’Union dispose d’une compétence d’appui (12) en matière de santé (article 6, a) TFUE), le traité prévoit certaines exceptions lui permettant d’adopter aussi dans ce domaine des actes d’harmonisation (article 4, §2, k) TFUE). Cette dérogation concerne, en particulier, les mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la protection de la santé publique (article 168, §4, b) TFUE). Sur le triple fondement des bases juridiques concernant la santé publique, l’établissement, le fonctionnement du marché intérieur (article 114 TFUE) et la politique agricole commune (article 43 TFUE), le législateur de l’UE a adopté le règlement 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il constitue l’instrument qui permet à des substances actives, telles que le glyphosate, d’être autorisées dans l’Union. Son prédécesseur avait permis la mise sur le marché des néonicotinoïdes et du fipronil, dont la dangerosité pour la santé des abeilles semble aujourd’hui avérée (13). Cependant, cette somme d’instruments ne constitue pas, en tant que telle, un droit à un environnement sain ». Elle permet de former un champ d’étude, rassemblant un ensemble de règles disparates. Elle n’en constitue pas pour autant un droit ou un principe, entendu comme une norme dotée à la fois d’un degré suffisant de généralité et de complétude pour pouvoir emporter par elle-même des conséquences juridiques. En outre, la somme de ces instruments semble seulement manifester la constance de la volonté politique du législateur de l’Union – aussi heureuse qu’elle puisse être. Elle n’en manifeste pas pour autant le respect d’une obligation constitutionnelle qui s’imposerait à lui. La volonté politique semble dépasser le droit. Elle apparaît alors réfractaire à un réel contrôle juridique. Certaines normes inscrites dans les traités semblent pouvoir garantir ce droit à un environnement sain. Par exemple, la Cour a accepté, ce qui n’était pas évident, que les objectifs qui définissent la politique que peut mettre en œuvre le législateur de l’Union, listés à l’article 191 TFUE, puissent aussi servir à juger de la légalité des actes qu’il adopte. Cependant, l’article 191 TFUE accorde …
La Décision FIE contre Irlande : un important précédent pour la lutte contre le changement climatique ?
Par Pauline Greiner, membre de Notre Affaire à Tous Introduction « Cette décision mémorable reconnaît le besoin pressant de répondre à l’urgence climatique et crée un précédent à suivre pour toutes les cours dans le monde » (1). C’est ainsi que David R. Boyd, Rapporteur Spécial de l’ONU sur les droits de l’Homme et l’environnement qualifie la décision rendue le 31 juillet 2020 par la Cour Suprême d’Irlande, annulant le plan national d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre (GES) du gouvernement irlandais (2) et contraignant celui-ci à en adopter un nouveau. Ce plan, adopté en 2017 en application de la loi de 2015 sur l’Action Climatique et le Développement Bas Carbone (3) (ci-après « loi de 2015 »), est censé décrire les politiques mises en œuvre par le gouvernement sur la période 2017-2022 pour atteindre son « objectif national de transition » (ONT). Le plan est contesté après sa publication par l’association de protection environnementale Friends of the Irish Environment (FIE), qui le considère insuffisant et invoque la violation de droits constitutionnels tels que le droit à la vie, ainsi que d’un droit implicite à un environnement « compatible avec la dignité humaine », reconnu par la Haute Cour irlandaise un an auparavant (4). Plusieurs fois qualifiée « d’historique » (5), la victoire de FIE dans cette affaire est vue comme extrêmement encourageante pour l’évolution du contentieux climatique dans le monde. Pourtant, la décision ne reconnaît aucune violation des droits de l’Homme résultant de l’inaction climatique de l’État et écarte l’idée de l’existence du droit à un environnement sain. Si la décision de la Cour Suprême dans l’affaire FIE contre Irlande crée indéniablement un important précédent, particulièrement à l’échelle de l’Irlande (I), elle conserve néanmoins quelques limites (II). L’annulation de l’acte administratif : un important précédent pour l’évolution du contentieux climatique La « justiciabilité » de l’acte était un point très contesté par l’État en première instance : l’acte administratif que constitue l’adoption du plan par le ministre est-il examinable par le juge ? En effet, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, qui en droit irlandais comme en droit français est un principe à valeur constitutionnelle, le juge ne peut s’immiscer dans les décisions de politiques publiques du gouvernement sous prétexte que celles-ci ne sont « pas adaptées ». En première instance, le défendeur (l’État) avait souligné que le plan d’atténuation ne créait de droits ni n’imposait d’obligations et qu’il constituait donc un simple énoncé de politique gouvernementale non susceptible d’être examiné par le juge (6). La Haute Cour avait également conclu que la marge de discrétion laissée au gouvernement par la loi de 2015 pour la mise en œuvre de ses politiques de réduction des émissions de GES ne permettait pas au juge d’estimer que le plan était insuffisant au regard de cette même loi (7). Cependant, les juges de la Cour Suprême ont adopté une autre approche. En effet, l’article 4 de la loi de 2015 énonce quelques conditions précises que doit satisfaire un plan d’atténuation pour être valable. Ainsi, le respect de ces règles relève de l’obligation légale et non de la discrétion du ministre. Les juges estiment donc que le plan est « justiciable » et peut être examiné au regard de la loi de 2015 (8). Ce passage de la décision est important puisque désormais, en Irlande, il sera admis que les actes du gouvernement pris conformément à la loi de 2015 sur l’action climatique sont examinables par le juge. Il convient cependant de noter que cette loi ne pose pas d’exigences quant à la forme que devront prendre les politiques climatiques mises en place. Puisqu’il s’agit d’évaluer le respect d’une obligation légale et non les choix politiques du gouvernement, les juges peuvent soumettre le plan à leur examen. L’article 4 de la loi de 2015 exige que le plan fournisse des détails quant à la manière dont le gouvernement se propose d’atteindre l’ONT sur la période donnée. La Cour Suprême utilise dans son analyse le standard, habituel en common law, de la « personne raisonnable » (9) pour évaluer la compatibilité du plan avec cette exigence de détail. Pour la Cour, le plan doit permettre à « une personne raisonnable et intéressée de juger de si le plan en question est réaliste et de savoir si elle approuve les choix de politiques mises en place pour atteindre l’Objectif National de Transition » (10). Elle constate alors que le plan d’atténuation se trouve « excessivement vague ou ambitieux » par endroits (11), l’empêchant d’atteindre le niveau de spécificité requis par la loi. C’est pour cette raison que la Cour Suprême décide de l’annuler. Cette décision établit un important précédent, au moins au niveau national. Un plan d’action climatique, pour être valable, doit être suffisamment transparent et détaillé, car c’est ce qui permet au public d’évaluer concrètement l’efficacité des politiques mises en place par le gouvernement et éventuellement de chercher à engager sa responsabilité. Cette décision clarifie l’obligation qu’a l’État irlandais d’atteindre un niveau satisfaisant de spécificité et de transparence dans ses futurs plans d’atténuation. Il sera désormais impossible pour le gouvernement de n’émettre que des objectifs de long-terme vagues sans détailler les mesures qui permettront de les atteindre, tout en invoquant la marge de discrétion pour éviter l’annulation de l’acte. La décision FIE constitue donc une première étape importante pour l’évolution du contentieux climatique en Irlande. En revanche, contrairement à ce que les requérants avaient pu espérer, elle ne passe pas le cap de la reconnaissance de la responsabilité de l’État pour violation des droits humains. Il convient donc d’examiner les limites de cette décision, qualifiée par beaucoup « d’historique ». Les limites de la décision FIE contre Irlande Malgré l’annulation de l’acte, la Cour Suprême a refusé de reconnaître la violation des droits humains protégés par la Constitution irlandaise et la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), pour des raisons d’ordre purement procédural. En ce qui concerne les droits explicitement reconnus par la Constitution, FIE invoque la violation du droit à la vie (12) et du droit à l’intégrité physique (13). La Cour a bien reconnu que puisque l’acte était ultra vires …
L’Insuffisante protection européenne du droit à un environnement sain
Par Salomé Cohen, membre de Notre Affaire à Tous Introduction « Beaucoup d’autres combats sont à mener mais si celui-ci échoue, plus aucun autre ne pourra être entrepris» (1). Tout au long de son ouvrage, Aurélien Barrau place l’Humanité face à ses contradictions. L’une d’entre elles consiste à défendre les droits humains sans y inclure celui d’évoluer dans un environnement sain. Aujourd’hui, près de 9 millions de décès prématurés dans le monde sont dus à la pollution atmosphérique. Cette dernière réduirait davantage l’espérance de vie que l’alcool, le tabac ou les violences (2), sans parler de la dégradation de la biodiversité et de son habitat, à l’origine de la crise sanitaire que nous traversons. Au vu de ce constat, des droits aussi fondamentaux que le droit à la vie et le droit à la santé ne peuvent qu’être bafoués. Il est aujourd’hui évident que les atteintes à l’environnement – comprenant l’inaction face à la crise écologique – violent les droits humains, pourtant reconnus par toutes les nations. Mais rien n’y fait, la répression supranationale des infractions écologiques est au point mort. Le vendredi 24 mai 2019, la protection effective d’un droit individuel à l’environnement se heurtait à un nouvel obstacle : l’échec des négociations pour l’adoption du Pacte mondial pour l’environnement. Alors que des juristes du monde entier appelaient les Nations Unies à voter en faveur d’un texte juridiquement contraignant, c’est une simple déclaration politique qui fut acceptée. Pourtant, ce projet se contentait de rendre obligatoire des principes depuis longtemps reconnus par les États. A première vue, la situation ne semble pas plus favorable au niveau régional ; seule la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples consacre le droit des peuples à un « environnement satisfaisant et global, propice à leur développement » (3). La lettre de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ci-après CEDH) ne mentionne aucun droit à la protection de l’environnement ou à la préservation de la nature (4). Cet instrument a été amendé plusieurs fois, sans jamais que ne soit ajouté le droit à un environnement sain. Ce dernier vise pourtant le droit dont dispose chaque être humain de vivre et évoluer dans un milieu équilibré et respectueux de sa santé, de son bien-être et de sa dignité. Bien que ce droit à l’environnement soit dépourvu de valeur conventionnelle, la Cour européenne des droits de l’homme joue un rôle dans sa promotion à l’égard des 47 membres du Conseil de l’Europe. Le contentieux européen de l’environnement représente en effet quelque 300 décisions, oscillant entre interprétation extensive de la CEDH et affirmation de la marge nationale d’appréciation. UNE INTERPRETATION EXTENSIVE DES DROITS DE L’HOMME AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT Les jurisprudences de la Cour européenne et de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme sont sources d’espoir. Une approche par l’entremise des droits humains existants, conventionnellement garantis, est adoptée afin d’inciter les États à protéger le droit à un environnement sain. L’inexistence conventionnelle du droit individuel à l’environnement A l’époque où la CEDH fut adoptée, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les préoccupations environnementales n’étaient pas au cœur des débats. Il est donc compréhensible que le texte européen, dans sa première version, ne mentionne pas de droit individuel à l’environnement. Même si de nombreux protocoles sont venus modifier le texte d’origine, aucun d’entre eux n’ajoute mention d’un droit à l’environnement. Dans sa Résolution 1614, l’Assemblée parlementaire avait pourtant recommandé au Comité des Ministres « d’élaborer un protocole additionnel à la Convention européenne des Droits de l’Homme, concernant la reconnaissance de droits procéduraux individuels, destinés à renforcer la protection de l’environnement, tels qu’ils sont définis dans la Convention d’Aarhus (5) » (6). Faute de fondement conventionnel, les requêtes relatives à l’environnement furent systématiquement rejetées par la Commission européenne en raison de leur incompatibilité avec la compétence matérielle de la CEDH (7). Ce n’est qu’à partir des années 1980 que la Commission a progressé dans le traitement des requêtes environnementales (8). Ces avancées sont à nuancer. Face à l’afflux des requêtes, le système de tri en amont de l’examen de la recevabilité devient de plus en plus exigeant. Lorsque les conditions ne sont pas remplies, la requête est définitivement rejetée. L’absence conventionnelle du droit à un environnement sain ne place évidemment pas les requêtes qui y sont relatives en priorité. La consécration prétorienne d’un droit d’accès à la justice environnementale Afin de favoriser l’accès à la justice environnementale, la Cour européenne passe notamment par une substantialisation des droits procéduraux. Dans sa logique de prééminence du droit, elle examine l’effectivité réelle et concrète des droits procéduraux tels que le droit à un procès équitable (9) et à un recours effectif (10). Le respect de ces derniers sont essentiels à la protection des droits substantiels garantis par la CEDH et donc à la protection par ricochet du droit à l’environnement. Dans cette dynamique, la Cour a affirmé que l’impossibilité pour les requérants d’obtenir le contrôle d’une décision gouvernementale relative à leur droit environnemental constituait une violation de l’article 6 de la CEDH (11). Cependant, elle précise que le droit invoqué doit avoir un caractère civil et qu’un lien suffisamment direct avec le problème environnemental doit être établi. Or, en matière environnementale, établir ce lien est une difficulté de taille. Elle le reconnaîtra cependant dans des affaires où la célérité, le coût ou encore la disponibilité des procédures judiciaires posent difficulté (12). L’article 34 de la CEDH précise que la requête peut émaner de « toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime (…) ». En matière environnementale, la Cour étend cet accès aux associations environnementales qui jouent, selon elle, le rôle de « chien de garde », essentiel pour une société démocratique (13). Cependant, la Cour limite cet accès aux associations qui défendent un intérêt public général (14). L’accès à la justice environnementale se lit également à travers la liberté d’expression de l’article 10§1 de la CEDH. La Cour a affirmé « un net intérêt général à autoriser de tels groupes et les particuliers en dehors du …
OEIL – Le premier projet du groupe local lyonnais !
Le groupe local de Lyon lance son premier projet baptisé “OEIL – l’observatoire écosystémique des inégalités lyonnaises” ! Depuis sa création en 2015, Notre Affaire à Tous s’est intéressée aux victimes françaises du dérèglement climatique. Loin de l’idée reçue affirmant que le dérèglement climatique serait une menace globale et uniforme, la notion d’inégalité environnementale et climatique est au cœur de la lutte contre le changement climatique. Au sein de la Métropole de Lyon, les territoires les plus défavorisés sont aussi les plus exposés à des nuisances environnementales. Inégalités socio-économiques et environnementales se juxtaposent. Différents facteurs tels que l’âge, le sexe, et le statut social des individus, qui comprend leurs ressources économiques, culturelles et sociales, amplifient la vulnérabilité des individus face au changement climatique. Poursuivant le travail d’enquête sur les vécus climatiques dans cinq grandes villes françaises réalisé en 2019, Notre Affaire à Tous – Lyon lance une étude sociologique, en partenariat avec le Master Éthique, écologie et développement durable de l’Université Jean Moulin de Lyon, première étape du projet OEIL. Les étudiant-e-s du Master, guidés par les bénévoles du groupe local de Lyon, rencontrent les habitant-e-s du Grand Lyon, afin de répertorier leurs impressions, sur les thèmes de la santé, l’environnement, l’alimentation ou encore le réchauffement climatique. Le résultat de cette étude servira de base pour mener une réflexion approfondie sur l’amélioration des politiques publiques en termes d’urbanisme, pollution, santé publique, environnement… Doublé d’une étude écotoxicologique sur l’exposome – l’ensemble des pollutions auxquelles l’humain est exposé – Notre Affaire à Tous choisit de croiser des données sociologiques et scientifiques afin de comprendre précisément les impacts de la pollution sur les habitant-e-s de la Métropole de Lyon. L’association tient à s’unir à la sphère universitaire ainsi qu’à la recherche pour produire des études approfondies et ainsi développer du contenu et de la réflexion sur ce sujet encore trop peu exploité des inégalités socio-environnementales. En documentant et sensibilisant aux impacts du changement climatique, Notre Affaire à Tous interpelle les pouvoirs publics afin qu’ils prennent réellement en compte les risques climatiques pour la population. L’urgence climatique est déjà ressentie par les citoyen-ne-s et nous mettons nos forces pour que les politiques renforcent leur capacité d’action afin d’endiguer la crise climatique. Nous sommes convaincu-e-s que le sujet des inégalités socio-environnementales est indispensable pour définir des mesures environnementales fortes adaptées à la réalité des citoyen-ne-s et propres à chaque territoire.
Lutter contre le changement climatique par la désobéissance civile, un état de nécessité devant le juge pénal ?
Par Paul Mougeolle et Antoine Le Dylio Résumé Face à la crise climatique, assistons-nous aux prémices d’une légitimation par les tribunaux de certains actes de désobéissance civile non violents ? Le tribunal de grande instance de Lyon semble s’engager dans cette voie, puisqu’il a prononcé la relaxe de deux militants prévenus du chef de vol en réunion à la suite du décrochage d’un portrait du président de la République dans la mairie du deuxième arrondissement de Lyon. En réaction aux débats suscités par ce jugement, ce commentaire interroge la possibilité de voir l’état de nécessité prospérer dans le contexte d’urgence environnementale. Introduction À la suite du décrochage du portrait du président de la République par des militants écologistes, largement relayé par les réseaux sociaux, la mairie du deuxième arrondissement de Lyon déposait plainte pour vol en réunion le 21 février dernier. Le portrait enlevé en présence de la presse n’a pas été restitué et serait conservé dans un lieu tenu secret afin d’être brandi lors de futures manifestations en faveur de la protection du climat. Les prévenus soutenaient qu’au regard des connaissances scientifiques actuelles, les accords internationaux et les voies légales empruntées demeurent insuffisants puisqu’ils ne permettent pas d’instaurer une politique efficace de lutte contre le changement climatique. En conséquence, des actions non violentes de désobéissance civile seraient selon eux nécessaires. Devant la catastrophe climatique annoncée, leur avocat plaidait donc la relaxe au nom de « l’état de nécessité ». Cette interprétation a été rejetée en bloc par le ministère public qui requérait leur condamnation à une amende de cinq cents euros. Au terme d’une argumentation singulière, le juge a prononcé la relaxe des prévenus. Certains titres de presse se sont alors fait l’écho de la reconnaissance d’un état de nécessité (1), mais cette affirmation doit être nuancée. La motivation du jugement s’inscrit certes dans l’esprit de cette notion – et les critères exigés apparaissent en filigrane – mais le juge n’y fait pas explicitement référence, sauf lorsqu’il expose la défense des prévenus. L’état de nécessité est admis pour la première fois comme cause exonératoire de responsabilité en 1898, par le « bon juge » du tribunal de Château Thierry (2), dans une affaire impliquant une mère de famille qui avait volé du pain « sous l’irrésistible impulsion de la faim ». Il faudra attendre la réforme de 1994 pour que le législateur introduise cette notion dans le Code pénal. L’article 122-7 prévoit désormais que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. » En l’espèce, pour retenir l’état de nécessité, le juge devait déterminer, d’une part, si les conséquences du changement climatique constituent pour les prévenus un danger actuel ou imminent (I/) et, d’autre part, si le décrochage de portraits du président de la République constitue une réponse nécessaire et non disproportionnée (II/). I/ – Un danger actuel ou imminent à identifier : le changement climatique ou l’insuffisance des politiques publiques ? La reconnaissance de l’état de nécessité suppose en premier lieu qu’un danger actuel ou imminent menace la personne qui accomplit un acte nécessaire à sa propre sauvegarde, à celle d’autrui ou celle d’un bien. Le juge n’hésite pas à qualifier le dérèglement climatique de danger grave, actuel et imminent (3), et la communauté scientifique s’accorde sur ce fait. En particulier, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié en décembre 2018 un rapport spécial (4) relatif aux effets d’un réchauffement climatique de 1,5 °C, dont les conclusions sont sans appel : les dangers encourus au-delà d’un tel réchauffement planétaire moyen sont non seulement « imminents », puisque cette situation surviendrait entre 2030 et 2050, mais surtout excessivement graves, tant pour les personnes que pour leurs biens. De surcroît, les effets du dérèglement sont déjà sérieusement perceptibles, y compris en France où canicules, sécheresses et incendies se multiplient en période estivale alors que le réchauffement moyen n’est que d’un degré. Le juge relève que ce dérèglement « affecte gravement l’avenir de l’humanité » mais également « l’avenir de la faune et de la flore ». Cette motivation s’inscrit pleinement dans la thèse, soutenue par la doctrine (5) et de nombreux recours (6), selon laquelle les États sont tenus à une obligation de lutter contre le changement climatique en raison d’atteintes sur l’environnement, mais aussi des atteintes aux droits fondamentaux des personnes, desquels se déduirait le droit de vivre dans un système climatique soutenable. Le droit à la vie est même convoqué à demi-mot par le magistrat lorsqu’il affirme que l’État ne respecte pas ses objectifs « pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital ». Le changement climatique représenterait donc selon le juge un danger grave, qui est actuel ou imminent. Mais dans le contexte de la présente affaire, admettre l’état de nécessité suppose en toute rigueur que ce soit la carence de l’État en matière climatique qui constitue un danger actuel ou imminent, ou au moins qu’elle y participe, dans la mesure où c’est au regard de cette carence que sera analysée l’adéquation des actes des prévenus. Le juge s’attache alors à caractériser la carence de l’État en relevant trois manquements corroborés par des données institutionnelles (Eurostat, SNBC, Commissariat général au développement durable). D’abord le dépassement de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixée par la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC) ; ensuite les manquements en matière de déploiement des énergies renouvelables ; et enfin l’échec de l’amélioration de la performance énergétique. Les personnes interrogées en qualité de témoin lors de l’audience avaient souligné cette carence : Wolfgang Cramer, scientifique en écologie globale, avait affirmé la nécessité d’un changement rapide de notre modèle de société pour limiter la hausse des températures. Quant à Cécile Duflot, militante écologiste, directrice d’Oxfam et ancienne ministre du Logement, elle a rappelé que des recours ont été engagés pour mettre fin à l’inaction de l’État, à savoir le recours en responsabilité dit « l’affaire du siècle » (7) porté devant le tribunal administratif de …
Les impacts de la loi relative au devoir de vigilance sur la gouvernance des entreprises multinationales
Article écrit par Paul Mougeolle, membre de Notre Affaire à Tous, juriste doctorant, Université Paris Nanterre Article publié dans le cadre du Séminaire EnCommuns qui s’est tenu le 17 mars 2019 sur le thème « La loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères de 2017, une nouvelle obligation pour les multinationales d’ entreprendre en commun ? ». 1. Introduction Comparée aux premières lois relatives à l’abolition de l’esclavage à la fin du XVIIIème siècle ou celles sur les droits sociaux des travailleurs du XIXème siècle (1), la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre représente un grand bond en avant en matière de responsabilité des multinationales. En effet, cette loi oblige les grandes entreprises à établir publiquement une véritable politique de vigilance afin de prévenir les atteintes graves aux droits de l’homme et à l’environnement, et ce tant en France qu’à l’étranger. L’objectif de la loi est donc à la fois simple et ambitieux : il s’agit de rendre « la mondialisation plus humaine » (2) en essayant notamment de mettre fin à l’esclavage moderne (3) et d’éviter de futures catastrophes industrielles telles que l’on a connues avec l’effondrement du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh (4), de l’explosion de l’usine Bophal en Inde dans les années 1980 ou celle d’AZF en France et les multiples marées noires comme par exemple celle résultant du naufrage de l’Erika (5). Afin de parvenir à remplir cet objectif, un dispositif légal introduisant un changement radical du statut quo était nécessaire. Une proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre a donc étéproposé par des députés de la majorité. Celle-ci a suscité nombreux débats et navettes parlementaires entre 2013 et 2017. A la toute fin du mandat de F. Hollande, près de trois ans et demi après le dépôt initial, la loi fût finalement promulguée le 27 mars 2017. Cela a marqué la fin d’un parcours semé d’embûches, car son entrée en vigueur était compromise jusqu’au bout. En effet, en raison du blocage du Sénat, du désaccord de la commission mixte paritaire et du manque de soutien du gouvernement, la proposition de loi n’aurait pu jamais voir le jour. Suite au compromis trouvé entre les députés de la majorité et le gouvernement après le départ de l’ancien ministre de l’économie Mr. Macron, le texte a pu être imposé malgré tout à l’Assemblée Nationale (A.N.) en lecture définitive. Cependant, l’étape du passage du texte devant le Conseil constitutionnel en raison de la saisine des 60 députés et 60 sénateurs de l’opposition était extrêmement redoutée à cause de la jurisprudence constitutionnelle particulièrement protectrice du principe de la liberté d’entreprendre des entreprises. Le Conseil avait même censuré une disposition de la loi Sapin 2 très similaire au devoir de vigilance à peine quelques mois plus tôt, et ce sur le fondement de ce principe (cf. il s’agissait d’une obligation faite aux grandes entreprises de divulguer publiquement leurs bénéfices non taxés dans des paradis fiscaux (6). La pression de la société civile a vraisemblablement pesé car le Conseil constitutionnel s’est manifestement détaché de sa jurisprudence antérieure (7). Juliette Renaud, seconde intervenante lors du séminaire, ajouta qu’il s’agissait d’une réelle surprise : les communiqués de presse préparés en avance étaient très pessimistes, et à cause de la censure de la disposition relative à l’amende civile de 10 à 30 millions d’euros (8), qui s’avère à première vue importante, les médias avaient titré que la loi a perdu son caractère contraignant (v. article des Echos, « Devoir de vigilance : le Conseil constitutionnel vide la loi de sa substance » (9). Cette censure partielle n’entame pourtant en rien la structure de la loi (cf. communiqué de presse collectif des associations et syndicats mobilisés sur la loi –: « Devoir de vigilance : le Conseil constitutionnel valide l’essentiel de la loi, un pas historique pour la protection des droits humains et de l’environnement, un signal fort pour l’Europe et l’international » (10). En tout état de cause, l’entrée en vigueur de cette loi avait fait grand bruit à l’international dans le domaine du businness & human rights (11). Celle-ci a même inspiré la première version officielle du Traité de l’ONU sur les entreprises transnationales et les droits de l’homme (12) et les experts juridiques évoquant assez unanimement une loi pionnière (13). Pour la première fois en France et dans le monde une règle de droit établit un régime de responsabilité des sociétés mères sur leurs filiales et leurs chaînes de sous-traitance. Le régime antérieur faisait prévaloir l’irresponsabilité en raison de l’indépendance de la personne morale (« voile » de l’autonomie de la personne morale, « corporate veil » en anglais) : la filiale est légalement autonome de la société mère, malgré la relation de contrôle. Juliette Renaud ajouta qu’il est possible et largement répandu dans le monde des affaires de faire remonter les profits vers la société mère, mais lorsqu’un dommage survient, les entreprises plaident la déconnexion légale entre la mère et les filiales ou sous- traitants ; l’objectif de la loi était donc de réconcilier les réalités économiques et juridiques. 2. Dispositions principales de la loi sur le devoir de vigilance Les rédacteurs de la loi n’ont pas opté pour une formulation très claire en ce qui concerne son champ d’application personnel. Quoi qu’il en soit, la loi concerne les sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre constituées en sociétés anonymes (14) ainsi que, par l’effet de renvois du Code de commerce, les sociétés commanditées par actions (SCA) et les sociétés européennes (SE). Il y a en revanche un débat sur l’inclusion des sociétés par actions simplifiées (SAS) (15). Ensuite, pour qu’une société mère soit soumise au devoir de vigilance, celle-ci doit employer en France « au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes » ou plus de « dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes » en France et à …
Quatorze témoignages de citoyens et citoyennes impacté-e-s par le dérèglement climatique !
Les dérèglements climatiques menacent les droits fondamentaux des citoyens français et ont un impact différencié selon les régions, les groupes sociaux et les secteurs d’activités. Nous donnons la parole à 14 personnes dont les vies sont déjà affectées par le dérèglement climatique. Ces témoignages illustrent l’ampleur de la crise climatique. Lire le rapport "Un Climat d’inégalités" Témoignage entier Ewilan Témoignage entier Marie Témoignage entier Jean-Louis Témoignage entier William Témoignage entier Alexis Témoignage entier Ricardo Témoignage entier Jean-François Témoignage entier Paulo Témoignage entier Ambre Témoignage entier François Témoignage entier Maurice Témoignage entier Raphaël Témoignage entier Jean Témoignage entier
CP / “Un climat d’inégalités” : un rapport inédit sur les impacts inégaux du dérèglement climatique en France
Le mercredi 9 décembre 2020 l’association Notre Affaire à Tous publie son rapport Un climat d’inégalités. Celui-ci met en lumière un phénomène encore trop peu documenté : les inégalités climatiques sur le territoire français. Ce rapport de 140 pages part d’un constat simple : 5 ans après la signature de l’Accord de Paris par la France, les actions ambitieuses en matière climatique se font toujours attendre et l’accélération du changement climatique pèse de manière inégale sur la population française. Le rapport publié par l’association met en lumière les conséquences désastreuses de ce retard. Il y a 5 ans, l’Accord de Paris introduisait pour la première fois le terme de justice climatique dans un traité international. La justice climatique se distingue des approches purement physiques et environnementales des changements climatiques en privilégiant une approche en termes de justice et d’équité face au dérèglement climatique. Aujourd’hui sur le territoire français, la justice climatique est encore loin d’être accessible et les inégalités se creusent. Le rapport “Un climat d’inégalités” les documente, les analyse et présente des pistes de travail qui devraient être au cœur de la politique climatique. Le changement climatique se nourrit des inégalités et les renforce Si le dérèglement climatique nous menace tou·te·s, il existe des différences d’impacts. Certaines populations et certains territoires sont plus exposés et plus vulnérables aux conséquences des changements climatiques. Ces inégalités climatiques peuvent être territoriales : les territoires montagneux, les littoraux, les territoires d’Outre-mer sont ainsi plus vulnérables. D’autres inégalités climatiques sont le résultat de structures sociales inégalitaires : inégalités socio-économiques, rapports de domination hommes/femmes, discriminations raciales etc. Par ailleurs, les conditions socio-économiques déterminent également la capacité des populations et des territoires à s’adapter aux changements climatiques. Les impacts différenciés du dérèglement climatique créent ainsi des inégalités climatiques qui viennent renforcer des inégalités sociales déjà existantes. Les citoyen·ne·s français·e·s, déjà exposé·e·s aux risques climatiques Alors que le phénomène est connu au niveau mondial, en France, les inégalités climatiques sont méconnues et peu documentées. Pourtant celles-ci se creusent. De 1999 à 2018, la France a été le 15ème pays le plus à risque face au dérèglement climatique à l’échelle mondiale et le premier à l’échelle européenne. Six Français·e·s sur dix sont déjà concerné·e·s par les risques climatiques. Il existe une triple peine. Alors que les plus pauvres ont une plus faible empreinte carbone, ils souffrent plus des conséquences : plus exposés aux risques climatiques, ils ont également moins de moyens pour y faire face et sont disproportionnellement impactés par la fiscalité environnementale. “Cinq ans après l’Accord de Paris, deux ans après le lancement de l’Affaire du Siècle et de la mobilisation des gilets jaunes, les citoyen·ne·s payent le prix de l’inaction climatique et les inégalités se creusent. Aujourd’hui, notre combat va au-delà des tribunaux. Ce que nous portons, c’est la justice environnementale et sociale. Si on agit, c’est pour rendre justice aux plus précaires, pour que personne ne soit laissé de côté. Après ces années critiques de défaillances climatiques, la réalité des inégalités climatiques et l’impératif de justice sociale doivent guider l’élaboration de politiques publiques pour permettre à toutes et tous de vivre dans une société de justice”. Clothilde Baudouin, responsable du projet “Inégalités climatiques” à Notre Affaire à Tous Quatorze citoyen·ne·s témoignent “L’érosion marine est de plus en plus fréquente. Dans nos métiers, nous sommes directement tributaires de l’environnement naturel. Déplacer nos productions vers le large est une manière de s’adapter… pour un temps… au changement climatique”.Jean-François Périgné, mytiliculteur sur l’île d’Oléron “Les sécheresses et les périodes de fortes chaleurs de ces dernières années rendent les saisons irrégulières et pénalisent nos cultures”.Raphaël Baltassat, agriculteur en Haute-Savoie Des conséquences en termes de droits fondamentaux, de conditions de vie et de santé, à la mise en danger des secteurs les plus vulnérables de notre économie, le rapport “Un climat d’inégalités”, ainsi que ses témoignages, dressent un panorama des inégalités climatiques en France, rappelant le lien intrinsèque entre enjeux sociaux et écologiques et la nécessité d’une transition juste. Contacts presse : Cécilia Rinaudo, Coordinatrice Générale : 06 86 41 71 81Clothilde Baudouin, Responsable du projet Inégalités Climatiques : 06 09 73 39 39 Lire le rapport complet