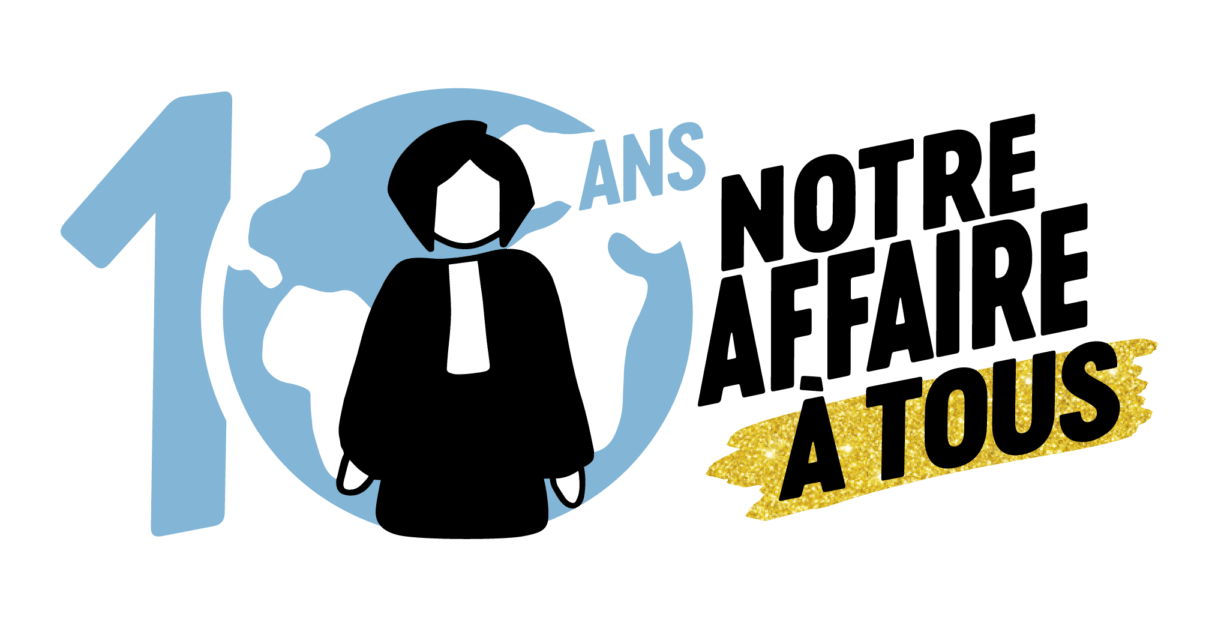Article rédigé par Chloé Lailler, Julie Zalcman et Clothilde Baudouin, membres de Notre Affaire à Tous
Introduction
Quel lien existe-t-il entre la protection de l’environnement et l’antiracisme ? Ces deux enjeux peuvent paraître a priori éloignés. Pourtant, depuis plus de 40 ans, le mouvement pour la justice environnementale a mis en lumière la manière dont les discriminations créent et renforcent les inégalités écologiques. Le racisme, vu comme une discrimination liée à la hiérarchisation entre des “races”, est alors apparu comme un prisme d’étude des inégalités environnementales. Après être revenues sur l’émergence de la notion de racisme environnemental dans l’histoire plus large de la justice environnementale, de ses figures et luttes emblématique, nous étudierons le concept de racisme environnemental, sa pertinence et ses limites. Puis, nous nous intéresserons à plusieurs cas d’injustices environnementales en France et à la manière dont la nouvelle génération de militant·e·s écologistes se saisit aujourd’hui de ces enjeux.
Le mouvement pour la justice environnementale aux États-Unis
Encore marginal en France, le mouvement pour la justice environnementale apparaît aux États-Unis dans les années 1980. Le sociologue Razmig Keucheyan est l’un des premiers en France à s’être intéressé à ce mouvement, dont il relate l’histoire dans son essai d’écologie politique “La nature est un champ de bataille ». Il insiste sur le fait que le mouvement pour la justice environnementale n’est pas né au sein du mouvement environnementaliste ou écologiste, mais est une émanation du mouvement pour les droits civiques des afro-américains.
En effet, le mouvement pour la justice environnementale fait le constat que les activités industrielles polluantes, et plus particulièrement les usines de stockage et de traitement des déchets toxiques, sont majoritairement situées à proximité des quartiers où vivent des classes populaires et des minorités ethniques (en particulier des amérindien·ne·s et afro-américain·e·s). Le choix de placer les activités polluantes à proximité de quartiers ouvriers et de quartiers où vivent des minorités s’explique par le fait que ces populations ont moins de ressources (économiques, sociales, etc.) pour s’opposer à l’implantation d’industries polluantes. Inversement, dans les quartiers où vivent des populations blanches et aisées, les entreprises polluantes encourent plus de risques juridiques et économiques. La décision de placer dans tel ou tel quartier une usine de traitement des déchets est donc déterminée par la ségrégation résidentielle, les inégalités socio-économiques et raciales. La dimension raciste d’une telle décision n’est pas forcément consciente ou intentionnelle chez les acteurs décisionnaires. Ce sont les habitant·e·s qui en sont victimes qui prennent conscience à la fin des années 1970 de la discrimination raciale qui sous-tend la répartition territoriale des décharges.La prise de conscience de ces inégalités environnementales entraîne plusieurs mobilisations, dans la lignée de celles menées par le mouvement des droits civiques. Une première action juridique a lieu en 1979 avec la décision Bean v. Southwestern Waste Management Corp.(1). Des résident·e·s de Houston, représenté·e·s par l’avocate Linda McKeever Bullard, s’opposent alors à l’installation d’une décharge municipale à côté de leur domicile. La plaidoirie de l’avocate s’appuie sur l’Equal Protection Clause du 14ème amendement de la Constitution américaine, qui dispose qu’“aucun État ne pourra, dans sa juridiction […] dénier à une personne une protection identique à celle inscrite dans les lois”. Par ailleurs, les plaignant·e·s commandent une étude au sociologue Robert D. Bullard (l’époux de Linda McKeever Bullard), afin de documenter la localisation des décharges publiques à Houston. Cette étude, intitulée “Solid Waste Sites and the Black Houston Community” (2), met en évidence le fait que les décharges municipales sont majoritairement situées dans des quartiers habités par des afro-américain·e·s, alors même qu’ils·elles ne représentent que 25% de la population de la ville. Cette affaire permet ainsi de reconnaitre pour la première fois l’existence d’une discrimination raciale en matière d’exposition aux déchets et pollutions. Le professeur Robert Bullard sera l’un des principaux théoriciens du racisme environnemental, processus d’exclusion territorial qu’il définit comme :
“l’ensemble des politiques, des pratiques et des directives environnementales qui ont des conséquences négatives disproportionnées, qu’elles soient intentionnelles ou non, sur certaines personnes, certains groupes ou certaines communautés en raison de leur race ou de leur couleur” (3).
Au-delà des actions juridiques, le mouvement pour la justice environnementale mobilise le même répertoire d’actions que le mouvement des droits civiques (4) : manifestations, sit-in ou encore boycotts. Une première grande mobilisation de ce type a lieu en 1982 dans le comté de Warren en Caroline du Nord, où les habitant·e·s se sont opposé·e·s à l’implantation d’un site d’enfouissement de déchets dangereux dans un quartier où 75% de la population était noire et 20% vivait sous le seuil fédéral de pauvreté. Si les riverain·e·s ont perdu l’action en justice contre l’enfouissement des déchets, leur mobilisation a pris une ampleur considérable. De nombreuses actions directes non violentes ont été organisées pour bloquer les camions transportant les déchets toxiques et plus de 550 militant·e·s ont été arrêté·e·s. Cette action de désobéissance civile de masse a réellement marqué la naissance du mouvement pour la justice environnementale et a permis une prise de conscience dans l’opinion publique américaine de l’accumulation de deux formes de discriminations : l’une environnementale, l’autre raciale.
L’émergence du concept de racisme environnemental dans le sillage du mouvement pour la justice environnementale
Suite à cette première grande mobilisation, des universitaires et des militant·e·s ont alors mené des enquêtes de terrain pour documenter ce phénomène. Le terme de “racisme environnemental” a été utilisé pour la première fois par le révérend Benjamin Chavis, compagnon de route de Martin Luther King, qui dirigeait la commission pour la justice raciale de la United Church of Christ, et qui a coordonné en 1987 le rapport “Toxic Wastes and Race in the United States” (5). C’est la première étude nationale qui croise les données géographiques et démographiques sur l’implantation des sites de traitement des déchets toxiques aux États-Unis. Le rapport établit ainsi que “although socio-economic status appeared to play an important role in the location of commercial hazardous waste facilities, race still proved to be more significant” (6).
Le racisme environnemental désigne ainsi un type d’inégalité environnementale qui prend racine dans une organisation sociale raciste. S’il n’existe pas forcément une intention directe de nuire aux populations, le racisme environnemental est un phénomène arbitraire, le résultat d’une histoire sociale, de hiérarchies, de rapports de pouvoir et de dominations. Les inégalités raciales sont ainsi corrélées à des inégalités géographiques, économiques et sociales. La hiérarchisation raciste d’une société, la marginalisation et les discriminations visant certains groupes ethniques renforcent les risques pour ces personnes d’être plus impactées par les pollutions industrielles, les catastrophes environnementales ou encore les événements météorologiques extrêmes. Il convient donc de distinguer le racisme environnemental d’autres formes d’inégalités environnementales.
L’étude coordonnée par le révérend Chavis aura un impact politique puisqu’en 1994, le président Bill Clinton signe l’Executive Order 12898 (7) qui fait de la justice environnementale un objectif de politique publique au niveau fédéral. Cet Executive Order insiste tout particulièrement sur la nécessité d’agir contre les discriminations environnementales que vivent les minorités ethniques et les populations à faible revenu.
En 2005, la catastrophe de l’ouragan Katrina ravive la question du racisme environnemental. En effet, les quartiers afro-américains de la Nouvelle-Orléans sont dévastés par l’ouragan, car mal protégés par les digues et situés dans des zones inondables, tandis que les quartiers blancs et aisés, situés dans les hauteurs de la ville, sont plutôt épargnés. Cette catastrophe met ainsi en lumière l’intersection de plusieurs inégalités que sont l’âge, la classe sociale, la couleur de peau et le genre. En effet, un tiers de la population de la Nouvelle-Orléans vit sous le seuil de la pauvreté (8) et deux tiers des habitant·e·s de la ville sont noir·e·s. Parmi les victimes de la catastrophe, les personnes âgées et les noir·e·s sont surreprésentés. En effet, 67% des personnes décédées avaient plus de 65 ans. Si l’on analyse les décès de personnes de moins de 65 ans, on constate que les personnes noires représentent 82% des victimes (9). On estime de plus que 80% des adultes laissés-pour-compte suite à l’ouragan étaient des femmes (10). Les grandes vulnérabilités et la moindre résilience sont deux conséquences frappantes de ces inégalités.
Plus récemment encore, une autre affaire de racisme environnemental a éclaté dans le Michigan : c’est l’affaire de l’eau contaminée au plomb à Flint (11), une ville où 57% des habitant·e·s sont afro-américain·e·s. En 2014, pour faire des économies, le gouverneur a décidé de changer la source d’approvisionnement de l’eau de la ville et de puiser dans la rivière Flint (12), polluée par des déversements de déchets d’usines. La pollution de l’eau (13) a rongé les canalisations en plomb qui n’ont pas été traitées. L’eau a ainsi été contaminée au plomb (14), provoquant de graves impacts sanitaires (15) pour la population et plus particulièrement pour les bébés et jeunes enfants : dommages cérébraux, retards de développement ou encore risques accrus de troubles comportementaux et respiratoires.
Ainsi, le mouvement pour la justice environnementale a émergé, s’est construit et a été porté par les personnes noires afro-descendantes et les personnes en situation de précarité en réaction au racisme environnemental et aux inégalités socio-économiques et de genre. Ce mouvement est donc né dans un contexte précis et localisé, celui des États-Unis de la fin du XXème siècle, et le racisme environnemental a été théorisé à partir des expériences de discriminations subies par les minorités ethniques en Amérique du Nord. Pendant plusieurs années, voire décennies, ce mouvement a eu peu d’impacts en dehors des États-Unis, mais depuis quelques années des chercheur·euse·s et militant·e·s se saisissent de l’enjeu du racisme environnemental pour analyser les exemples d’injustices environnementales en France. Ainsi, existe-t-il des exemples similaires de racisme environnemental en France ? Quelles pourraient être les applications mais aussi les limites du concept de racisme environnemental en France ?
Existe-t-il un “racisme environnemental” en France ?
Il existe peu de littérature au sujet du racisme environnemental en France hexagonale. Les discriminations et inégalités que subissent les personnes racisées ne sont presque jamais étudiées au prisme des inégalités écologiques. Le racisme environnemental est également difficile à mesurer en France car l’utilisation des statistiques ethniques est plus restreinte qu’aux États-Unis. En effet, il est interdit en France de traiter des données à caractère personnel laissant apparaître directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques des personnes. Pour mesurer les discriminations raciales, les statisticien·ne·s s’appuient donc sur d’autres données comme le nom de famille, la nationalité de naissance ou encore le pays de naissance des personnes concernées et de leurs parents. Certaines études se basent aussi sur le “ressenti d’appartenance”, c’est-à-dire les sentiments d’injustice ou de discrimination des personnes interrogées.
L’enquête “Trajectoire et origines” menée par l’INED en 2016 avec le soutien de l’INSEE est l’outil de référence sur la mesure des discriminations et des inégalités raciales en France (16). Cette étude démontre la forte ségrégation résidentielle qui touche les immigré·e·s et leurs descendant·e·s, et plus particulièrement la concentration des Africain·e·s subsaharien·ne·s, des Maghrébin·e·s et des Turc·que·s dans les quartiers modestes. Or, ces quartiers défavorisés sont touchés par plusieurs inégalités écologiques : mauvaise qualité de l’air, pollutions diverses, proximité d’usines Seveso, nuisances sonores, etc.
En 2014, Lucie Laurian et Richard Funderburg sont les premiers à s’intéresser à ces questions en France. Ils publient alors une étude sur la localisation des incinérateurs en France depuis les années 1960 (17). Les deux chercheurs font le constat que pour chaque pourcentage supplémentaire d’immigré·e·s présent·e·s dans une ville, la probabilité de trouver un incinérateur augmente de 29%. Il existe donc une inégalité d’exposition aux risques de pollutions industrielles.
Ces premières études sont complétées par de nouvelles et par le vécu des personnes racisées. Le racisme environnemental apparaît alors dans le paysage français comme une réalité, notamment lorsque l’on s’intéresse aux trois grandes situations où le facteur raciste est prégnant : celle des banlieues et quartiers populaires, celle des aires d’accueil des “Gens du Voyage” et celle des Outre-mers. En effet, dans ces trois cas, on observe que le lieu de résidence, le logement, les transports, le travail sont autant de domaines qui montrent que les conditions de vie des personnes racisées les exposent à des risques environnementaux et climatiques importants.
Lieu de résidence et environnement dégradé
L’existence d’une inégalité d’exposition aux risques environnementaux en France, démontrée par l’étude de Laurian et Funderburg en 2014, conduit à la surreprésentation des populations racisées dans des lieux de vie à l’environnement dégradé et pollué.
Les banlieues et quartiers défavorisés
Ainsi, d’après une étude dirigée par Séverine Deguen, certains quartiers populaires où se trouvent une majorité de personnes racisées sont aussi plus exposés à la pollution de l’air, principalement causée par la circulation automobile, et la mortalité suite aux pics de pollution y est plus élevée (18). Ce phénomène concerne notamment les habitant·e·s vivant au nord et à l’est de Paris, ou encore les habitant·e·s de Saint-Denis vivant près du périphérique et de l’autoroute A1, où sont enregistrés les pics de pollution les plus importants. À Paris intramuros la situation peut paraître paradoxale : les quartiers riches du centre et de l’ouest sont parmi les plus pollués, du fait des grands axes de circulation automobile, notamment aux abords des quais de Seine ou sur les grands boulevards. Pourtant, c’est dans les quartiers pauvres du nord et de l’est que la mortalité enregistrée suite aux pics de pollution est la plus élevée.
Les conditions d’existence et l’état de santé peuvent expliquer la plus grande vulnérabilité des habitant·e·s des quartiers pauvres face à la pollution de l’air, du fait de divers facteurs : une mauvaise qualité de l’air intérieur, un temps plus conséquent passé dans les transports en commun, l’insalubrité des lieux de travail ou encore un moindre accès aux aménités environnementales. Ce phénomène parisien des quartiers riches plus pollués que les quartiers défavorisés ne se reproduit cependant pas dans d’autres grandes villes françaises comme Marseille ou Lille.
Bien qu’il n’y ait peu d’études françaises sur ces questions, ces éléments font écho à différentes études américaines sur l’impact de la pollution de l’air sur les communautés racisées aux États-Unis, où en moyenne les communautés non-blanches respirent 66% plus d’air pollué par le trafic routier que les communautés blanches en raison de l’emplacement géographique de leurs quartiers proches des sources de pollution (19). Les impacts sur la santé des personnes sont prouvés.
Les aires d’accueil des Voyageur·euse·s
L’inégalité environnementale liée à la pollution du lieu de résidence est particulièrement visible dans le cas des populations qui ne peuvent choisir librement leur lieu de vie et dépendent de l’autorisation ou de la tolérance des autorités locales ou nationales, comme les personnes catégorisées comme “Gens du Voyage”. Les Voyageur·euse·s souhaitant vivre selon leur mode de vie traditionnel ne peuvent vivre que sur les terrains autorisant leurs caravanes, principalement des aires d’accueil et terrains aménagés par les communes ou les Établissements Publics de Coopération Intercommunales (EPCI) en conformité avec un Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage qui définit le nombre d’aires et d’emplacements à construire (20). Ce sont donc les communes ou les EPCI concernées qui choisissent le site où sera aménagée l’aire d’accueil. Or, selon les recherches de William Acker, juriste et chercheur spécialisé sur ces problématiques, sur 50 départements et 700 aires d’accueil étudiées, plus de 62% des aires d’accueil sont situées dans des zones à fortes nuisances industrielles ou environnementales (21).
De même, dans une étude menée sur 122 aires d’accueil de 4 départements (le Nord, le Rhône, la Loire-Atlantique et la Haute-Garonne), Juliette Loiseau, journaliste, recense des pollutions et dégradations environnementales dans neuf cas sur dix (22), des chiffres similaires à ceux rapportés par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) dès 2009 (23). Cette étude souligne la présence des aires d’accueil dans des zones proches de déchetteries, de zones industrielles avec des usines polluantes et dangereuses ou encore d’autoroutes. Ainsi, l’aire d’accueil de Rouen-Petit Quevilly a été construite par la Métropole Rouen Normandie en pleine zone industrielle, à moins de 500 mètres de l’usine Lubrizol classée SEVESO, et celle de Saint-Menet par la Métropole Aix-Marseille-Provence à proximité immédiate de l’usine Arkema, également classée SEVESO seuil haut. Les aires sont régulièrement installées près de carrières et autres activités extractives, comme celle de Gex dans l’Ain (24), ou près d’autoroutes et de voies ferrées.
L’environnement dégradé des aires d’accueil des “Gens du Voyage” a donc de graves conséquences sur la santé des Voyageur·euse·s, qui ont une espérance de vie 15 ans inférieure à la moyenne nationale (25).
Les camps de migrant·e·s et de populations Roms
Les campements des populations Roms et migrantes sont également symptomatiques de ce racisme environnemental. En effet, les zones où ces campements sont tolérés, voire parfois encouragés, par les autorités sont des zones souvent polluées ou à l’environnement dégradé. De nombreux bidonvilles se trouvent en bordure d’autoroutes. Le campement d’exilés dit de la “Jungle” de Calais a ainsi été installé le long de l’autoroute, dans une zone en partie classée SEVESO (26), tout comme celui d’Angres quelques kilomètres plus loin (27). Mais la majorité des campements et bidonvilles se trouvent proches des déchetteries et lieux de dépôt de déchets polluants. C’est le cas par exemple de l’ancien bidonville de la plaine de Triel-Carrières dans les Yvelines, qui a servi d’égout sans aucun retraitement des eaux usées pendant des années, entraînant une forte pollution des sols aux métaux lourds (28).
Qualité du logement et sensibilité accrue aux événements climatiques extrêmes
Au-delà de la pollution environnante, c’est également la qualité du logement de certaines populations racisées qui est symptomatique d’un racisme environnemental. En effet, leurs lieux de vie les rendent beaucoup plus vulnérables aux événements climatiques, canicules, vagues de froid, tempêtes ou encore aux inondations, alors même que ces aléas météorologiques vont augmenter, en intensité et en fréquence, en raison du dérèglement climatique.
Lors de la canicule de 2003, le Val-de-Marne a été le département le plus sévèrement touché (surmortalité de + 171%), suivi du département de la Seine-Saint-Denis (surmortalité de +160%). Cette surmortalité s’explique par le phénomène des îlots de chaleur urbain, mais aussi par les conditions de vie des habitant·e·s : logements surpeuplés et mal isolés, peu d’espaces verts, difficultés d’accès à l’eau pour certaines populations, état de santé général dégradé ou encore mauvaise diffusion des informations sur les bonnes pratiques pour se protéger des fortes chaleurs.
Les habitant·e·s des quartiers populaires sont aussi plus vulnérables aux vagues de froid. Selon une enquête de l’Observatoire des Zones Urbaines Sensibles, 30,8% des habitant·e·s des ZUS ont connu en 2006 des périodes de froid dans leur logement en raison d’une mauvaise isolation ou de problèmes d’installation et de mise en route du chauffage, contre 13% pour le reste de la population.
Au-delà des banlieues et des quartiers populaires, les terrains, bidonvilles et campements où vivent des personnes racisées (exilé·e·s, Voyageur·euse·s ou encore Roms), souvent situés dans des zones en marge des villes, sont pour beaucoup extrêmement vulnérables aux aléas climatiques et météorologiques. Par exemple, les fortes pluies sont souvent à l’origine d’inondations dans ces bidonvilles, comme à la “Jungle” à Calais en 2016 (29) et dans un camp de migrant·e·s près de Toulouse suite à une crue de la Garonne en 2019 (30). À l’inverse, les habitant·e·s des campements sans accès à l’eau sont parmi les premier·ère·s touché·e·s par les sécheresses et les canicules (31) qui seront plus fréquentes, avec des conséquences pouvant être dramatiques : en 2019, une personne est décédée sur un campement rom à Montpellier des suites de la canicule (32).
La mauvaise qualité des logements de personnes racisées est aussi à l’origine de pollutions intérieures. Le sociologue Razmig Keucheyan présente ainsi le saturnisme comme un cas de racisme environnemental. Le saturnisme est une intoxication causée par la contamination de l’eau au plomb ou par l’inhalation de poussières de peintures au plomb dégradées. En France, cette maladie ancienne a fait son retour dans les années 1980. Le saturnisme concerne majoritairement les enfants de migrant·e·s d’Afrique subsaharienne, à Paris et dans les banlieues. En Angleterre, ce sont les enfants d’immigré·e·s indien·ne·s qui sont le plus touchés par le saturnisme et aux États-Unis la maladie touche majoritairement les enfants afro-américains et les enfants d’immigré·e·s d’Asie du Sud. Les pollutions au plomb présentes dans les logements anciens et insalubres où vivent les immigré·e·s sont à l’origine des cas de saturnisme infantile. Anne-Jaune Maudé parle ainsi d’une “maladie sociale de l’immigration” (33).
Travail et exposition aux risques environnementaux
Les études sur les risques environnementaux liés au travail intègrent rarement des analyses en termes d’inégalités sociales. Pourtant, la question du racisme est prégnante. Les métiers exposés à des risques environnementaux du fait de l’utilisation de produits cancérigènes sont majoritairement exercés par des personnes racisées : ce sont notamment des femmes d’origine subsaharienne qui font le ménage avec des produits toxiques dans les bureaux des entreprises, des hommes racisés qui ramassent les poubelles, des saisonniers maghrébins qui ramassent les légumes dopés aux pesticides dans les champs du sud de la France, pour ne citer que quelques exemples.
De même, les études et documentations sur les situations économiques et sanitaires des personnes qui vivent dans des bidonvilles, comme certaines personnes Roms ou exilées, peuvent être lues sous le prisme du racisme environnemental dont ces personnes sont victimes. Ainsi, des études concernant des populations Roms démontrent qu’elles sont parfois forcées à travailler dans des opérations clandestines de recyclage de déchets informatiques ou polluants, car privées d’autres opportunités d’emploi. Des entreprises ou des particuliers contournent les circuits officiels et réglementés en déposant les déchets près ou dans les bidonvilles pour ne pas payer le coût du recyclage (35), créant des décharges sauvages, comme à Villejuif (94) (36). Ces décharges entraînent de fortes pollutions et dégradations environnementales ainsi que des risques sérieux pour la santé des personnes traitant et vivant près de ces déchets polluants et toxiques. En 2010, l’ONG Médecins du Monde alertait sur les forts taux de saturnisme et d’intoxication au plomb dans les communautés roms vivant dans des bidonvilles de différentes régions de France, en particulier les enfants qui jouent près des déchets et des fumées toxiques issues de l’incinération de divers matériaux (37).
Inégalités d’accès à la nature et aux ressources naturelles
En plus des inégalités d’exposition aux risques environnementaux, s’ajoutent les inégalités d’accès à la nature, ce qu’on appelle les aménités environnementales. Ces espaces sont souvent rares à proximité des lieux de vie des personnes racisées, par exemple les aires d’accueil des Voyageur·euse·s bétonnées et les quartiers populaires avec très peu – voire aucun – parcs ou jardins. De même, les opportunités de vacances à la mer, à la montagne ou dans des résidences secondaires à la campagne sont rares, voire inexistantes, pour les habitant·e·s des tours HLM de banlieues. Les communes modestes ont également moins de budget pour développer et entretenir leurs espaces verts.
Le manque d’accès à la nature signifie également un manque d’accès aux ressources qu’elle fournit. Ainsi, le racisme environnemental se manifeste aussi par des difficultés d’accès aux ressources naturelles et à l’environnement. Par exemple, les campements de personnes migrantes ou Roms sont souvent situés dans des zones où l’accès à la nature et à ses ressources, notamment l’eau, est extrêmement limité. En moyenne, 77% des bidonvilles en France n’ont pas d’accès à l’eau potable sur site (38) et ce chiffre peut s’élever à 91% dans certains départements comme l’Essonne et le Val-de-Marne selon le CNCDH-Romeurope (39). Si aucune étude globale n’a été menée sur les minorités racialisées et l’environnement en France, le Bureau Européen de l’Environnement souligne l’ampleur du phénomène du racisme environnemental en Europe centrale et orientale qui touche 154 000 Roms dont les lieux de vie se situent dans des zones polluées et avec un accès difficile aux ressources naturelles et environnementales (40).
Les inégalités d’accès à l’eau sont aussi frappantes entre le territoire métropolitain et les Outre-mers. En Guyane, 4,5% des habitant·e·s n’ont pas accès à des services de base d’eau potable (environ 35 000 personnes) et à Mayotte 16,3% des habitant·e·s n’ont pas accès à des services d’eau potable gérés en toute sécurité (environ 41 000 personnes) (41).
L’écologie décoloniale et la demande de justice des citoyen·ne·s ultramarins : l’affaire du chlordécone
Chronologie du chlordécone et de son histoire antillaise
Les Antilles françaises ont une histoire très similaire à celle des États-Unis. La colonisation de ces territoires par les occidentaux a conduit au génocide des peuples autochtones et à la mise en place de la traite négrière. La déportation d’Africain·e·s noir·e·s et l’esclavage ont conduit au développement de plantations de canne à sucre qui ont fait la richesse des colons. Si l’esclavage a été définitivement aboli en 1948, les inégalités sociales, économiques et raciales issues de l’histoire coloniale des Antilles perdurent encore aujourd’hui. Le scandale du chlordécone est un exemple d’inégalité environnementale causée par la structuration néocoloniale de la société antillaise.
Le chlordécone est un insecticide qui a été utilisé pour lutter contre le charançon, un insecte qui ravage les cultures de bananes. Or, la banane est le fruit le plus cultivé aux Antilles et le 2ème fruit le plus consommé en France. Les ravages du charançon représentaient donc une menace réelle pour l’économie antillaise. Le Kepone, premier pesticide à base de chlordécone, est mis sur le marché américain en 1958. En 1963 une première étude démontre la toxicité du chlordécone sur les animaux. En 1972 la France délivre une autorisation de mise sur le marché provisoire pour le chlordécone. À peine deux ans plus tard, une mission d’enquête de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) alerte sur l’éco-toxicité du chlordécone. En 1976, les États-Unis interdisent la vente et l’utilisation du chlordécone après le scandale de Hopewell, du nom de la ville où se trouvait une usine de production de Kepone et où des ouvriers ont été contaminés et où la rivière James a été polluée.
Dès les années 1970, plusieurs études ont démontré la toxicité du chlordécone. Le produit a ainsi été interdit aux États-Unis dès 1976. En France, le chlordécone ne sera interdit que quinze plus tard, en 1990. Malgré cette interdiction, l’État a accordé deux dérogations pour continuer d’utiliser le chlordécone aux Antilles. Pour justifier cette exception antillaise alors que la toxicité du chlordécone était établie, l’argument de l’épuisement des stocks a été invoqué. Or, le propriétaire de l’entreprise qui produisait le chlordécone était aussi le président du groupement des producteurs de bananes en Martinique. Cet homme, Yves Hayot, est issu d’une riche et puissante famille de békés, les descendants des premiers colons européens (42). Grâce à la dérogation qu’il a obtenue, le chlordécone a pu être utilisé officiellement jusqu’en 1993 aux Antilles. L’interdiction du chlordécone aux Antilles est alors intervenue 17 ans après son interdiction aux États-Unis. En outre, malgré son interdiction, des stocks de plusieurs tonnes de chlordécone retrouvés en 2002 laissent croire que certains agriculteurs ont continué à utiliser l’insecticide de façon illégale pendant près de dix ans.
Le scandale du chlordécone
Le scandale du chlordécone éclate à la fin des années 1990 lorsque des analyses révèlent une pollution des cours d’eau avec un taux de chlordécone largement au-dessus des normes. 18 000 hectares seraient ainsi contaminés à des degrés différents, soit ¼ de la surface agricole de la Martinique et de la Guadeloupe. Il s’agit d’une pollution généralisée : la pollution des sols a contaminé les nappes phréatiques, les cours d’eau et les littoraux. On estime qu’un aliment sur dix serait aujourd’hui contaminé aux Antilles. C’est donc l’ensemble de la production agricole qui est concernée : les fruits et légumes mais aussi la viande et le poisson. Certaines zones maritimes, proches du rivage, sont désormais interdites à la pêche du fait de cette pollution.
L’injustice environnementale que représente l’intoxication au chlordécone a de multiples facettes. Il s’agit d’abord d’une inégalité d’impact : les premières victimes sont les ouvriers agricoles qui travaillaient dans les bananeraies et ont été en contact direct avec l’insecticide. Cette intoxication concerne aujourd’hui l’ensemble de la population antillaise puisque selon une étude de 2013 de Santé Publique France, 95% des Guadeloupéen·ne·s et 92% des Martiniquais·es sont contaminés (43). Bien que la banane soit à l’origine de l’utilisation du chlordécone, celle-ci a été peu contaminée car la molécule reste dans le sol et affecte peu les fruits. La banane, dont 70% de la production est exportée en France hexagonale, a donc été épargnée par la pollution au chlordécone ce qui n’est pas le cas des tubercules, notamment la pomme de terre, qui constitue la base de l’alimentation des antillais·e·s.
L’impact sur la santé humaine est également considérable. Le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Il a des conséquences sur le développement cognitif et moteur des enfants, pose des risques élevés d’infertilité, de naissances prématurées, d’endommagement du système nerveux et serait à l’origine d’une survenance élevée du cancer de la prostate chez les personnes contaminées. En effet, en Martinique, chaque année, 227 nouveaux cas de ce cancer sont déclarés pour 100 000 habitant·e·s (44). La région détient aussi le “record” de la survenance de ce cancer.
L’affaire du chlordécone met aussi en lumière une inégalité de responsabilité. Pour le philosophe Malcom Ferdinand, “c’est une minorité qui a choisi le chlordécone et a imposé de vivre en milieu contaminé au reste de la population” (45). En effet, ce sont les grands propriétaires de bananeraies, majoritairement des békés, qui ont choisi d’utiliser le chlordécone et ont effectué un lobbying important pour légaliser son usage. En découle dès lors un sentiment d’injustice profond.
Quelle articulation entre racisme environnemental et écologie décoloniale ? Quels sont les apports et les limites de ces deux concepts ?
L’écologie décoloniale peut être définie comme une approche de l’écologie qui prend en compte les systèmes de domination existants, notamment ceux liés au colonialisme et au néocolonialisme. Ce concept permet de voir certaines inégalités qui peuvent être incluses dans notre manière même de penser la protection de l’environnement, comme ce que le chercheur historien Guillaume Blanc qualifie de “colonialisme vert” dans son étude de la gestion différenciée des parcs naturels africains et européens, démontrant comment l’écologie et la protection de l’environnement sont mises au service du néocolonialisme (46). Ses recherches montrent que dans un même cadre, celui du parc naturel, le système de pensée appliqué à la protection environnementale ne sera pas le même selon que le parc se situe en Europe ou en Afrique. La conception du parc européen inclura l’humain, agriculteur, berger, qui participe à la préservation des espaces et s’adapte à l’environnement. À l’inverse, le parc africain est conçu en opposition à l’humain, y compris les populations agricoles et pastorales vivant écologiquement dans ces espaces depuis des dizaines ou des centaines d’années, populations perçues comme destructrices de l’environnement et qui sont alors expulsées de leurs lieux de vie (47).
Cet exemple montre à la fois les liens entre les concepts de racisme environnemental et d’écologie décoloniale, et leurs différences. Les points communs sont liés à la construction d’un rapport à l’environnement différent en fonction d’un critère ethnique et racisé, qu’il soit conscient ou non. Ils font tous les deux partis de “l’éco-racisme” développé par Martin Melosi dès 1995 (48). Le concept de racisme environnemental permet de penser le biais raciste dans le sens où il met en avant les inégalités environnementales et la concentration des populations racisées dans des environnements pollués, dégradés et éloignés des ressources naturelles et le fait que les personnes racisées sont les premières touchées par les problèmes environnementaux. L’écologie décoloniale, quant à elle, se place d’un point de vue plus étatique et de relations internationales.
Et maintenant : comment agir contre le racisme environnemental ?
Le racisme environnemental révèle les inégalités environnementales qui touchent plus particulièrement les personnes racisées. Si elles sont plus souvent impactées par les pollutions, les minorités ethniques sont également sous-représentées au sein des institutions politiques, des associations environnementales et des partis politiques écologistes. Cette homogénéité sociale du milieu écologiste est une autre facette du racisme environnemental qui doit interroger le mouvement climat.
Ce contexte peut être expliqué de plusieurs façons. Les personnes racisées ont des préoccupations plus urgentes liées à leur situation économique et aux diverses discriminations qu’elles subissent. Le temps disponible est en effet un privilège souvent nécessaire pour s’investir dans les luttes écologistes. Un sentiment d’illégitimité peut également être un frein à l’implication dans les milieux militants, ainsi que le manque de réseau et une invisibilisation des personnes racisées dans ces cercles.
En France, contrairement aux États-Unis, le mouvement écologiste ne s’est pas fondé en corrélation avec les questions sociales. Or, les rapprochements récents entre les mouvements sociaux et les mouvements pour la justice climatique nous amènent à nous questionner sur nos luttes et nos valeurs. La justice climatique à laquelle nous aspirons, universelle et inclusive, est-elle réellement accessible à toutes et tous ?
Les victimes d’inégalités environnementales se situent souvent à l’intersection de différents rapports de domination, dont les rapports de classes sociales, les inégalités de genre, le racisme et l’âge. Si nous voulons agir pour la justice environnementale et climatique, les milieux militants, universitaires et scientifiques doivent prendre en compte la multiplicité et l’enchevêtrement des facteurs de vulnérabilités qui peuvent renforcer les inégalités écologiques.
La dénonciation du racisme environnemental s’intègre ainsi dans le combat pour la justice climatique et environnementale et vient l’enrichir de nouvelles perspectives. Parce que nous aspirons à un monde habitable pour tou·te·s et une société respectueuse de la diversité biologique et humaine, nous devons agir contre le racisme environnemental qui accentue les inégalités environnementales et climatiques.
Notes :
- Bean v. Southwestern Waste Management Corp., Significance, Waste Management In Houston, Laches And State Action, Impact, Further Readings, https://law.jrank.org/pages/13187/Bean-v-Southwestern-Waste-Management-Corp.html
- Bullard, R.D. (1983), Solid Waste Sites and the Black Houston Community*. Sociological Inquiry, 53: 273-288. https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.1983.tb00037.x
- https://drrobertbullard.com/
- Razmig Keucheyan, La nature est un champ de bataille, Essai d’écologie politique, 2014
- Toxic Wastes and Race in the United States: a National report on racial and socio-economic characteristics of communities with hazardous waste sites, Commission for Racial Justice, United Church of Christ, 1987.
- Traduction : “Bien que le statut socio-économique semble jouer un rôle important, le critère de la race est la variable la plus significative pour expliquer la localisation des stockages de déchets dangereux (décharges, incinérateurs, bassins de retenue).”.
- Executive Order 12898 of February 11, 1994, Federal Actions To Address Environmental Justice in Minority Populations and Low-Income Populations, https://www.archives.gov/files/federal-register/executive-orders/pdf/12898.pdf
- Ezekiel, Judith. « Katrina à La Nouvelle-Orléans : réflexions sur le genre de la catastrophe », L’Homme & la Société, vol. 158, no. 4, 2005, pp. 189-200.
- Patrick Sharkey, Survival and death in New Orleans: An empirical look at the human impact of Katrina, Journal of Black Studies, 2007, https://doi.org/10.1177%2F0021934706296188
- Laura Butterbaugh, Why did Hurricane Katrina Hit Women So Hard?, Off Our Backs, Vol. 35, No. 9/10 (sept-oct 2005), pp. 17-19, https://www.jstor.org/stable/20838463
- États-Unis.Cinq ans après, la crise de l’eau n’en finit pas à Flint, Courrier International, 26 avril 2019, https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/etats-unis-cinq-ans-apres-la-crise-de-leau-nen-finit-pas-flint
- Yona Helaoua, Eau contaminée : les habitants de Flint dénoncent un « racisme environnemental », France 24, 10 février 2016, https://www.france24.com/fr/20160210-etats-unis-us-eau-contaminee-flint-pauvres-noirs-empoisonnes-racisme-environnement
- Sylvie Laurent, Flint : les noces empoisonnées de l’austérité et du racisme, Libération, 4 février 2016, https://www.liberation.fr/planete/2016/02/04/flint-les-noces-empoisonnees-de-l-austerite-et-du-racisme_1431082/
- Flint, ville symbole du « racisme environnemental » ?, Sciences et Avenir, 6 mars 2016, https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/flint-ville-symbole-du-racisme-environnemental_17843
- Frédéric Autran, A Flint, les damnés de plomb, Libération, 28 janvier 2016, https://www.liberation.fr/planete/2016/01/28/a-flint-les-damnes-de-plomb_1429653/
- Trajectoires et origines, Enquête sur la diversité des populations en France, sous la direction de Cris Beauchemin, Christelle Hamel et Patrick Simon, Collection : Grandes Enquêtes,2016, 624 pages
- Lucie Laurian & Richard Funderburg, 2014. « Environmental justice in France? A spatio-temporal analysis of incinerator location, » Journal of Environmental Planning and Management, Taylor & Francis Journals, vol. 57(3), pages 424-446, March.
- Deguen S, Petit C, Delbarre A, Kihal W, Padilla C, et al. (2016) Correction: Neighbourhood Characteristics and Long-Term Air Pollution Levels Modify the Association between the Short-Term Nitrogen Dioxide Concentrations and All-Cause Mortality in Paris. PLOS ONE 11(3): e0150875. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0150875
- Voir par exemple l’étude de l’Union of Concerned Scientist publiée en 2019 et intitulée “Inequitable exposure to air pollution” : https://www.ucsusa.org/resources/inequitable-exposure-air-pollution-vehicles ou encore les travaux de l’association américaine Lung : https://www.lung.org/clean-air/outdoors/who-is-at-risk/disparities
- Voir Loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 dite Loi Besson, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000583573/2020-09-28/
- William ACKER, “Dans l’enfer des aires d’accueil des Gens du Voyage”, Blog Médiapart, 9 juillet 2020,https://blogs.mediapart.fr/william-acker/blog/090720/dans-lenfer-des-aires-daccueil-des-gens-du-voyage
- Juliette LOISEAU, “Santé : l’empoisonnement à petit feu des gens du Voyage”, Médiacités, 24 août 2020, https://www.mediacites.fr/enquete/national/2020/08/24/sante-lempoisonnement-a-petit-feu-des-gens-du-voyage/?#annexe-1
- Réseau Européen d’information sur le racisme et la xénophobie, France RAXEN National Focal Point, Thematic Study on Housing Conditions of Roma and Travellers, mars 2009, Agence de l’Union Européenne pour les Droits Fondamentaux, p.43, https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/580-raxen-roma_housing-france_en.pdf
- William Acker, “Dans l’enfer des aires d’accueil des Gens du Voyage”, Blog Médiapart, 9 juillet 2020,https://blogs.mediapart.fr/william-acker/blog/090720/dans-lenfer-des-aires-daccueil-des-gens-du-voyage
- Selon une étude de Santé publique France, https://www.santepubliquefrance.fr/docs/sante-des-gens-du-voyage-des-associations-se-mobilisent
- Voir de nombreux articles de presse de l’époque, comme celui du Monde : https://www.lemonde.fr/societe/article/2015/10/19/la-jungle-de-calais-est-majoritairement-situee-en-zone-seveso_4792559_3224.html
- Angres : à 100 km de Calais, « Vietnam City », discret camp de migrants aux mains de passeurs, France 3 Hauts-de-France, 5 avril 2018, https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/angres-100-km-calais-vietnam-city-discret-camp-migrants-aux-mains-passeurs-1453071.html
- https://reporterre.net/Dans-les-Yvelines-la-pollution-des-sols-au-plomb-menace-la-sante-des-enfants
- https://www.bfmtv.com/diaporama/new-jungle-a-calais-un-bidonville-vu-du-ciel-3054/des-inondations-10/
- https://www.facebook.com/watch/?v=592510498163722
- Nathalie BIRCHEM, “Vivre en bidonville pendant la canicule”, La Croix, 28 juin 2019 : https://www.la-croix.com/France/Vivre-bidonville-canicule-2019-06-28-1201031936
- Hélène Amiraux, Un mort pendant la canicule dans un bidonville de Montpellier : « Une situation indigne, et inhumaine », Midi Libre, 4 juillet 2019, https://www.midilibre.fr/2019/07/04/mort-dun-homme-dans-un-bidonville-de-montpellier-une-situation-indigne-et-inhumaine,8294276.php
- Le saturnisme, une maladie sociale de l’immigration, Anne-Jeanne Naudé, Hommes & Migrations, Année 2000, pp. 13-22
- Carolyn LEBEL, Steven WASSENAAR, “Revealed: Scandal of the Roma people forced to scavenge toxic e-waste”, The Ecologist, Novembre 2010, pp.6-10, https://s3.amazonaws.com/external_clips/133917/Roma_Ecologist_November2010.pdf?1350724378
- Voir par exemple : https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/essonne/essonne-il-denonce-la-pollution-d-un-bidonville-grace-son-drone-5985018
- https://94.citoyens.com/2020/decharge-industrielle-sauvage-villejuif-en-appelle-a-darmanin,07-09-2020.html et https://www.villejuif-ecologie.fr/courrier-de-natalie-gandais-a-monsieur-darmanin-ministre-de-linterieur-contre-la-decharge-sauvage-des-hautes-bruyeres/
- Voir par exemple à Lyon : https://www.lyonmag.com/article/19118/l-etat-de-sante-des-roms-de-la-rue-paul-bert-inquiete
- Novascopia, Programme national de médiation sanitaire, 2015 : données recueillies dans 53 bidonvilles et squats de 8 départements français
- CNDH Romeurope, Situation au 2 avril 2020, Situation des personnes vivant en squats et bidonvilles en France métropolitaine, https://www.romeurope.org/wp-content/uploads/2020/04/CNDH-Romeurope-Situation-au-02-04-2020-Squats-et-bidonvilles.pdf
- Patrizia HEIDEGGER, Katy WIESE, “Pushed to the wastelands : Environmental racism against Roma communities in Central and Eastern Europe”, Rapport,European Environmental Bureau, 8 avril 2020 : https://eeb.org/library/pushed-to-the-wastelands-environmental-racism-against-roma-communities-in-central-and-eastern-europe/
- https://leauestundroit.fr
- Un béké est un habitant blanc créole de la Martinique ou de la Guadeloupe descendant des premiers colons européens. Le frère d’Yves Hayot est Bernard Hayot, propriétaire du groupe Bernard Hayot et 275ème fortune de France.
- Imprégnation de la population antillaise par le chlordécone et certains composés organochlorés en 2013/2014, Santé Publique France, octobre 2018
- Estimations régionales et départementales d’incidence et de mortalité par cancers en France 2007-2016, Santé Publique France, Francim, Institut national du cancer, janvier 2019
- Chlordécone : “Cette contamination est une atteinte au corps des antillais, https://www.youtube.com/watch?v=HNMemxTqyj4
- Guillaume BLANC, L’invention du colonialisme vert : pour en finir avec le mythe de l’Eden africain, Paris : Flammarion, 2020.
- “L’invention du colonialisme vert, Entretien avec Guillaume Blanc”, Esquisses, 14 septembre 2020 : https://elam.hypotheses.org/3142
- Martin V. MELOSI, “Equity, Eco-racism and Environmental history”, Environmental History Review, Volume 19, Issue 3, Fall 1995, Pages 1–16, https://doi.org/10.2307/3984909 : En Afrique du Sud, après l’Apartheid, les populations noires sont discriminées écologiquement, car elles doivent vivre dans des quartiers où l’accès à l’eau et à l’assainissement est très limité, voire inexistant, et qui sont proches des sources de pollution. Dans le même temps, elles sont considérées comme ne savant pas gérer les ressources naturelles.