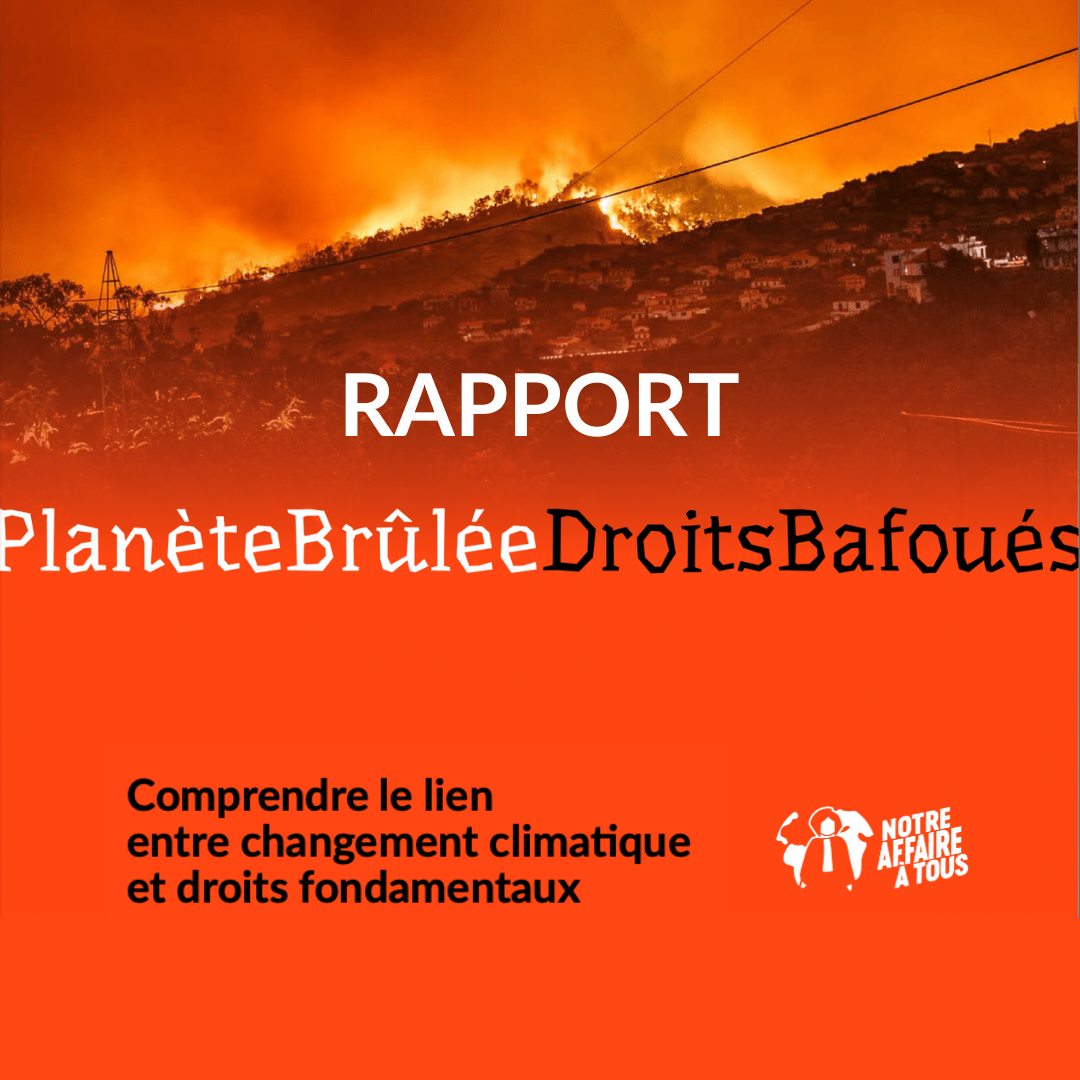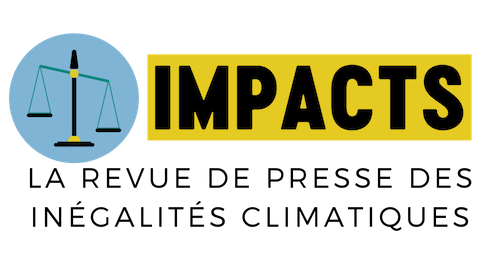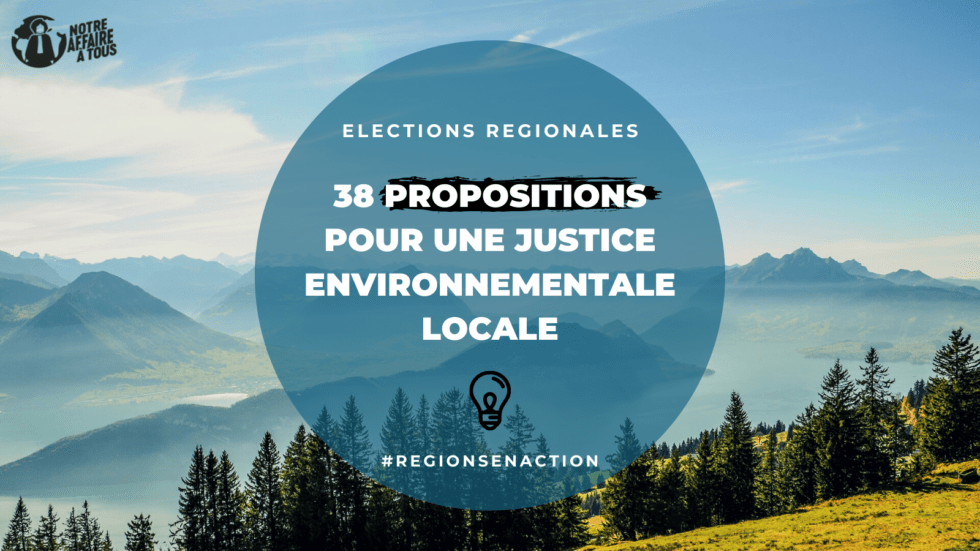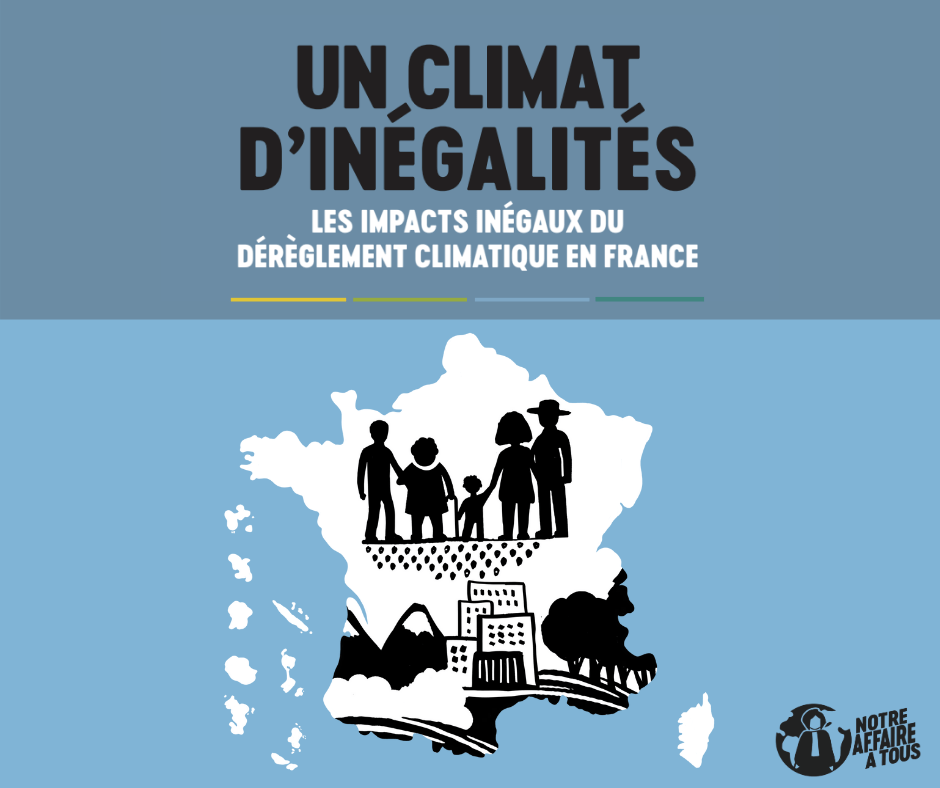Ce 17e numéro de la revue de presse « IMPACTS« se concentre sur les conséquences du dérèglement climatique sur l’alimentation et l’agriculture et sur la nécessaire refonte du système alimentaire actuel.
À un mois de la COP26 qui se déroulera à Glasgow du 1er au 12 novembre, le changement climatique et les phénomènes climatiques extrêmes se font de plus en plus intenses et mettent en péril la sécurité alimentaire de populations du monde entier. Et la France n’échappe pas à cette situation. Désertification, salinisation des sols, variations de la pluviosité amenant sécheresses ou inondations soudaines, évolutions climatiques auxquelles les cultures ne sont pas adaptées et/ou favorisant la prolifération de parasites et de maladies… autant de défis auxquels doit faire face l’agriculture afin de pouvoir continuer à nourrir la planète.
L’agriculture a cette spécificité qu’elle peut être considérée à la fois comme une victime principale du dérèglement climatique, mais aussi une de ses causes majeures, ainsi qu’une éventuelle solution, relève Bruno Parmentier, ingénieur et économiste spécialisé dans les questions agricoles et alimentaires.
Pour combattre les inégalités sociales climatiques et environnementales, il nous faut les connaître. C’est le sens de cette revue de presse élaborée par Notre Affaire à Tous, qui revient sur les #IMPACTS différenciés du changement climatique, sur nos vies, nos droits et ceux de la nature.
Le dérèglement climatique, facteur de graves crises alimentaires
Se nourrir est un besoin vital et un droit humain fondamental, inscrit dans le droit international depuis 1966 avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Selon le rapporteur spécial des Nations Unies, le droit à l’alimentation se définit comme “le droit d’avoir un accès régulier, permanent et libre, soit directement, soit au moyen d’achats monétaires, à une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et collective, libre d’angoisse, satisfaisante et digne”. Pourtant, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en 2020, plus de 2,3 milliards de personnes (soit 30% de la population mondiale) n’avaient pas accès toute l’année à une alimentation adéquate. Par ailleurs, elle estime que 9,9% environ de la population était en situation de sous-alimentation en 2020, contre 8,4% en 2019. Selon Action contre la Faim, aujourd’hui, ce sont jusqu’à 811 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et ce chiffre augmente pour la cinquième année consécutive. Une hausse de 161 millions de personnes a été observée rien que sur l’année 2020. Dans le rapport de 2018 sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde, l’ONU avertissait sur “l’impact du climat sur la sécurité alimentaire et la nutrition”. L’organisation soulevait alors que les catastrophes climatiques avaient doublé depuis 1990, ce qui avait nuit à la production agricole et contribué aux pénuries alimentaires.
Dans le rapport de 2021, l’avertissement s’est mué en alerte : la faim dans le monde s’aggrave considérablement. Ils relèvent trois facteurs majeurs de l’accroissement de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition : les conflits, les chocs économiques (exacerbés par la pandémie de covid-19), ainsi que la variabilité du climat et les phénomènes climatiques extrêmes.
Un autre rapport publié en mars dernier par la FAO soulève l’augmentation constante de l’intensité et la fréquence des catastrophes météorologiques, mais aussi biologiques dues aux changements climatiques. Ainsi, les inondations, les tempêtes, les sécheresses, les méga-incendies, mais aussi les ravageurs, les maladies et infestations des cultures et du bétail ont des effets dévastateurs sur la sécurité alimentaire et les moyens d’existence. D’autant plus que ce sont les pays les moins avancés (PMA) et les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFM) qui supportent la majeure partie de ces fléaux. La FAO relève que de 2008 à 2018, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes ont été les régions les plus durement touchées, ayant subi à elles seules plus de 108 milliards dollars (USD) en dommages ou en pertes de récoltes et de production animale. L’impact de ces catastrophes, au cours de la même période, se traduit aussi par une perte de 698 calories par habitant et par jour en moyenne dans ces quatre régions. Néanmoins, un avenir résilient aux catastrophes est possible selon la FAO, par un investissement dans la collecte et l’analyse de données, par des collaborations intersectorielles ou encore par des partenariats public-privé.
Action contre la Faim alerte elle aussi sur les conséquences de la crise climatique sur la faim dans le monde. Désormais, pour l’ONG, “agir pour le climat, c’est lutter contre la faim”. En 2020, selon l’ONU, le nombre de personnes souffrant de la faim à cause de chocs climatiques s’élevait à 15 millions de personnes. Ainsi, les difficultés d’accès physique et économique aux moyens de production, la perte d’accès à l’eau pour les cultures et le bétail, la fragilisation des rendements des exploitations et de la qualité des aliments produits ainsi que la destruction de ressources alimentaires sont quelques unes des conséquences directes des dérèglements climatiques. Toujours selon l’ONU, Madagascar serait le premier pays à subir la famine à cause du réchauffement climatique. Aucun conflit n’est en cause, seulement plusieurs années de sécheresse. Lola Castro, directrice régionale du Programme alimentaire mondial (PAM) pour le sud de l’Afrique évoque une “situation très dramatique” mais prédit aussi que “le pire est à venir” car la famine ne cesse de progresser, et met en danger la vie de plus d’un million de personnes. Selon elle, l’aide de la communauté internationale est urgente et indispensable, les fonds manquent et les agences humanitaires peinent à sensibiliser le reste du monde. Au Kenya, 2,1 millions de personnes risquent également de mourir de faim en raison d’une sécheresse massive qui sévit dans la moitié du pays et qui affecte les récoltes. Les agriculteurs ne sont pas les seuls à être touchés par la sécheresse. En effet, les habitants des zones urbaines sont aussi contraints de payer plus cher le peu de nourriture disponible.
Les impacts directs du dérèglement climatique sur les productions agricoles
Les conséquences du dérèglement climatique sur les rendements agricoles sont d’ores et déjà documentées. Elles sont d’autant plus importantes que l’agriculture est intimement liée à la problématique de l’eau, 93% des ressources hydriques disponibles dans le monde étant utilisées à des fins agricoles selon l’hydrologue Emma Haziza. Il faut 1 tonne d’eau pour produire 1kg de céréales, 4 à 11 tonnes pour produire 1kg de viande. Les désertifications, sécheresses et difficultés d’approvisionnement en eau ont et auront un impact important sur les rendements agricoles. Des cultures-phares comme le riz, le maïs et le café sont concernées.
De façon globale, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nature Climate Change, le dérèglement climatique a entraîné une baisse de 21 % de la croissance agricole mondiale depuis les années 1960. Un chiffre important pour une hausse de la température moyenne du globe de 1°C, alors que les modèles climatiques prévoient des hausses de températures globales bien plus importantes d’ici la fin du siècle, rappelle la chercheuse Delphine Renard. Selon le GIEC, des cultures essentielles car bases de l’alimentation humaine comme le blé et le maïs subissent déjà aujourd’hui les effets du dérèglement climatique, et estime que les baisses de rendement des céréales de 10 à 25 % pourraient être courantes dans les années 2050, amenant de fortes hausses de prix et donc du coût des denrées alimentaires. Par exemple, selon une étude publiée dans Agronomy for Sustainable Development, les rendements de riz pluvial au Sénégal pourraient être divisés par deux d’ici à 2100.
Preuve de ces conséquences, 2021 a été une année compliquée, voire catastrophique pour les agricultrices et agriculteurs de France et d’ailleurs, et le changements climatique en est grandement responsable.
Parmi les ravages causés par le changement climatique cette année en France, figure le gel tardif d’avril, qui n’a épargné aucune exploitation française. L’évènement a été analysé par le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie comme “probablement la plus grande catastrophe agronomique de ce début de XXIe siècle”. Les pertes pour la viticulture et l’arboriculture ont été estimées à plus de 4 millions d’euros. Le réseau international de scientifiques World Weather Attribution établit que le changement climatique a augmenté d’environ 60% la probabilité qu’une vague de froid survienne en période de bourgeonnement cette année. Ils expliquent que ces vagues de froid sont devenues moins probables et moins intenses qu’au siècle dernier en raison du réchauffement des températures, mais qu’elles font plus de dégâts car elles surviennent au moment où la végétation se réveille. Et le phénomène risque de s’accentuer année après année si les températures continuent d’augmenter.
En juin, après le gel tardif, puis des épisodes violents de vent et de grêle, les agriculteurs ont de nouveau été touchés par les aléas climatiques avec des orages qui ont endommagé les exploitations agricoles de nombreuses régions françaises. Les trois quarts de la France ont été touchés et certaines parcelles ont été détruites à 100%, comme en Côte d’Or ou dans le Doubs. Les pertes économiques sont considérables, tout comme l’impact moral pour les agriculteurs qui se sentent impuissants. L’accroissement de l’intensité et de la fréquence de ces évènements ne laissera pas d’autre choix que de réfléchir à un nouveau système agricole, en plus de refonder complètement l’assurance-récolte.
En raison des aléas climatiques qui se sont succédé cette année, la récolte française de vin devrait être en baisse de 24 % à 30 % en 2021, selon le ministère français de l’Agriculture, qui évoque un niveau de rendement d’une faiblesse jamais vue depuis quarante-cinq ans. Les évolutions climatiques ont plus encore de conséquences sur la production de vin, qui représente à elle seule 15% de la valeur de la production agricole française. En effet, l’augmentation des températures favorise et accélère la mutation des vignes, et rend ainsi les vendanges de plus en plus précoces. Les vendanges se font donc lors de températures estivales, ce qui favorise l’oxydation des grappes de raisin et leur fait perdre des qualités organoleptiques, à moins que la cueillette ne se fasse de nuit. De plus, les hautes températures augmentent la concentration en sucre des raisins, donc après transformation, la teneur en alcool du vin. Ce sont aussi la qualité du vin et la singularité des vins qui sont impactés. Enfin, l’apparition d’agents pathogènes, comme les ravageurs, les champignons pathogènes et les insectes, deviendra de plus en plus fréquente.
Les abeilles, elles aussi, ont souffert des aléas du climat. La récolte de miel de cette année n’atteindrait ainsi que 30% à 40% de celle de l’année dernière. Les trois conditions nécessaires à une bonne récolte, le soleil, la floraison et la santé de la colonie, n’ont jamais été réunies en même temps cette année, selon Dominique Cena, vice-président de l’UNAF. La période de gel puis de fortes pluies, émanant directement des changements climatiques, a empêché les abeilles de sortir et a retardé les floraisons. La situation est particulièrement difficile pour les petits apiculteurs qui n’ont pu tirer aucun profit de leurs abeilles. Si certaines abeilles sont nourries au sirop de glucose, les apiculteurs peinent à maintenir leurs prix. Privilégier la consommation de miel français est ainsi essentiel pour soutenir les apiculteurs.
Au niveau mondial, un autre produit particulièrement touché par les changements climatiques est le blé dur, utilisé pour fabriquer les pâtes et dont la production n’est concentrée que dans quelques régions du monde. Ainsi, l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes pourrait entraîner une pénurie de pâtes. La vague de chaleur qu’a connu le Canada à la fin du mois de juin dernier devrait réduire de 32% la récolte de blé par rapport à la moyenne des cinq dernières années, alerte le Syndicat des industriels fabricants de pâtes alimentaires de France (Sifpaf), alors que le pays représente ⅔ du commerce mondial de blé dur habituellement. À part le Mexique et le Maroc, qui récoltent leur blé plus tôt dans l’année, tous les pays producteurs de blé dur ont été durement touchés par les évènements climatiques extrêmes cet été. Selon une étude de l’Institut international pour l’analyse des systèmes appliqués, des sécheresses simultanées, graves et prolongées séviront dans le monde, même si le réchauffement climatique venait à se stabiliser. D’autres productions importantes ont également souffert, comme les amandes en Californie.
De plus en plus d’ouvriers agricoles souffrent donc économiquement des changements climatiques, mais ils sont aussi de plus en plus nombreux à en souffrir physiquement. Cela a été particulièrement flagrant cet été dans le nord-ouest des États-Unis, où une vague de chaleur record a causé la mort de plusieurs travailleurs et questionné leurs droits face à leur vulnérabilité climatique. Une étude universitaire américaine publiée en 2015 révèle que les travailleurs agricoles courent 35 fois plus de risques de décès liés à la chaleur que les autres travailleurs, et que ces risques augmentent. Pourtant, aucune loi n’oblige les employeurs à fournir de l’eau, de l’ombre ou des pauses. D’autant plus qu’aux Etats-Unis, la majorité de 2,4 millions de travailleurs agricoles sont sans papiers et vivent avec la crainte d’être pénalisés ou expulsés s’ils s’expriment.
Afghanistan : les agriculteurs victimes du changement climatique : un exemple des conséquences systémiques du dérèglement climatique sur l’agriculture et l’alimentation
En Afghanistan, où une large partie de la population tire ses revenus de l’agriculture, la vulnérabilité au changement climatique est forte et a constitué un contexte favorable aux talibans dans la conquête du pays. Producteur de grenades, de pignons, de raisins, l’Afghanistan est déjà très fortement impacté par le changement climatique. Selon le Germanwatch Global Climate Risk, il est le 6ème pays le plus touché par le changement climatique. Ces dernières années, le pays a connu plusieurs disettes. Dans les montagnes du nord du pays, la fonte des neiges a été précoce et provoqué des inondations dans les champs et les systèmes d’irrigation, et le phénomène se double de chutes de neige sur la période hivernale en trop faible abondance. Dans le sud et l’ouest du pays, les épisodes de pluie diluvienne ont augmenté de 10 à 25% sur les trente dernières années. Ces catastrophes détruisent les récoltes, amenuisent les ressources des agriculteurs qui se retrouvent bien souvent dans l’obligation d’emprunter, et contribuent à une situation d’insécurité alimentaire. On estime qu’un tiers des Afghans sont en situation de crise ou d’urgence alimentaire liée à la sécheresse, alors que le pays a déjà traversé une sécheresse historique en 2018 et mis au moins 250 000 personnes sur les routes. Et on estime déjà que les récoltes de 2021 seront 20% inférieures à celles de 2020.
Ce contexte, cumulé à l’absence d’aide du gouvernement déjà très concentré sur l’effort de guerre, a nourri une colère qu’ont pu exploiter les talibans qui ont par ailleurs les moyens d’enrôler des paysans en leur offrant 5 à 10 dollars par jour – a contrario on estime qu’un agriculteur afghan gagne en moyenne 1 dollar par jour. Nadim Farajalla, expert sur le changement climatique à l’université américaine de Beyrouth, explique que les agriculteurs font souvent le choix d’abandonner leurs terres pour essayer de trouver de l’argent en ville et laissent ainsi des familles derrière eux. Les enfants de ces familles deviennent alors des proies plus faciles à recruter.
Ce n’est pas la première fois qu’un groupe terroriste tire ainsi partie du changement climatique, notent les experts. Boko Haram a pu tirer profit dans un passé récent du manque d’eau au lac Tchad et, l’État islamique, de l’extrême sécheresse en Syrie et en Irak.
Pour obtenir des revenus plus stables, de nombreux agriculteurs, notamment dans le sud du pays où la sécheresse a été la plus forte et les talibans les plus populaires, ont choisi de planter du pavot car il est moins gourmand en eau et plus rémunérateur. Ainsi, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime estime que les surfaces cultivées de pavot ont bondi de près de 40 % en 2020 après quelques années de baisse. Or, les talibans qui contrôlent le marché de l’opium prélèvent des taxes chez les agriculteurs, ce qui constitue pour le groupe islamiste une source d’enrichissement supplémentaire.
Un rapport pointe une autre menace liée au changement climatique qui pèse sur la population : la rareté de l’eau. Les infrastructures sont en très mauvais état à cause des conflits répétés, et la capacité de stockage en eau par habitant est l’un des plus faibles de la région. A Hérat, une ville stratégique de l’ouest, les talibans ont ainsi “attaqué à plusieurs reprises un barrage qui est essentiel pour l’eau potable, l’agriculture et l’électricité pour les habitants de la région”, détaille le New York Times. Si ce manque d’eau a permis aux talibans de s’emparer des villes, il ne faut pas oublier que la situation pourrait se retourner contre eux une fois arrivés au pouvoir s’ils n’arrivent pas à assurer les services de base à la population.
Des solutions envisagées vers la résilience et l’adaptation climatiques
Le changement climatique affecte les récoltes et le bétail avec un telle rapidité, que des changements progressifs ne suffisent plus. En effet, l’augmentation de la chaleur, de l’aridité et de l’élévation du niveau de la mer menacent la survie de millions de petits agriculteurs et bouleversent la sécurité alimentaire mondiale. Ainsi, dans un rapport publié en juin dernier par le World Resources Institute, les chercheurs plaident pour des changements plus larges et radicaux des systèmes alimentaires, afin de s’adapter aux nouveaux défis climatiques. Déjà près de 800 millions de personnes dans le monde souffrent de la faim, un nombre qui a augmenté de 60 millions au cours des cinq dernières années. Le changement climatique contribue à augmenter ces chiffres et poussera probablement plus de 100 millions de personnes supplémentaires sous le seuil de pauvreté, dont beaucoup d’agriculteurs, éleveurs et autres ruraux. Pour eux, les changements radicaux consistent à déplacer les cultures dans des zones où le climat serait désormais plus adapté. Ils donnent l’exemple de producteurs de café costaricains, qui, dans la partie nord et plus aride du pays, cultivent désormais des agrumes, ou d’agriculteurs éthiopiens qui ont déplacé leurs parcelles dans des zones plus fraîches. Cependant, les chercheurs avertissent que les agriculteurs qui ont de petites exploitations et qui sont les plus vulnérables aux impacts climatiques, auront besoin de ressources pour s’adapter : plus de recherches, de subventions et d’incitations gouvernementales.
Selon une étude menée par des scientifiques du CNRS publiée en juin dernier, une cohabitation équilibrée entre agriculture et environnement pourrait être possible en Europe, par un remodelage complet de son système agroalimentaire. Ce scénario reposerait sur trois leviers. Le premier consisterait en un changement de régime alimentaire, notamment vers moins de produits d’origine animale, ce qui permettrait de limiter l’élevage hors-sol et de supprimer les importations d’aliments pour le bétail. Le deuxième levier s’inspirerait des principes de l’agroécologie en généralisant les systèmes de rotation des cultures. Ces cultures seraient diversifiées et intégreraient des légumineuses fixatrices d’azote, ce qui permettrait de se passer des engrais azotés de synthèse comme des pesticides. Et le troisième pilier reposerait sur la reconnexion de l’élevage avec les systèmes de culture en abandonnant leur concentration dans des régions ultra-spécialisées. Ce scénario permettrait ainsi de nourrir l’ensemble de la population européenne prévue pour 2050, tout en continuant d’exporter des céréales vers les pays qui en ont besoin pour l’alimentation humaine. De surcroît, la pollution des eaux et les émissions de gaz à effet de serre causés par l’agriculture seraient largement réduites, et le niveau de perte d’azote dans l’environnement serait divisé.
Pour adapter l’agriculture au changement climatique, le président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA), Sébastien Windsor, propose de la repenser. Il a ainsi annoncé le 24 août dernier un “plan pour une résilience globale des exploitations, porté par les chambres d’agriculture en 2022”. L’objectif est avant tout d’accompagner les agriculteurs sur le terrain, notamment en leur conseillant des variétés plus résistantes à la hausse des températures, aux gelées tardives, ou encore aux inondations en plus en plus fréquentes. Le plan d’action sera territorialisé, afin d’accompagner au mieux les agriculteurs de tout le pays dans leur transition. Les mesures dépendront par ailleurs des conclusions du Varenne agricole de l’eau et du changement climatique attendues pour début 2022. Le Varenne, lancé le 28 mai 2021 par le ministre de l’agriculture et la secrétaire d’Etat à la biodiversité, vise à concevoir une nouvelle gestion de l’eau en agriculture et à adapter toutes les filières agricoles aux évolutions du climat. Il se décline en trois groupes de travail sur la gestion des risques climatiques, sur la résilience de l’agriculture et sur la gestion partagée et raisonnée des ressources en eau. Une de ses ambitions est de refonder l’assurance récolte pour 2023, afin de prévenir et indemniser plus efficacement les agriculteurs victimes des aléas climatiques.
Refonder notre système alimentaire agro-industriel : une urgence face au dérèglement climatique et aux crises agricoles et alimentaires
On le sait, l’agriculture industrielle a sa part de responsabilité dans la crise écologique, agricole et alimentaire que nous sommes en train de vivre. C’est donc l’ensemble de notre modèle agricole actuel qu’il faut remettre en question pour penser l’agriculture de demain, et renoncer aux soucis productivistes pour parvenir à plus de résilience, de durabilité et de justice.
L’objectif premier du modèle agricole actuel est d’assurer une productivité et une rentabilité économiques optimales. C’est une agriculture industrielle, intensive et ultra mécanisée, dépendante des énergies fossiles, d’intrants (produits utilisés pour améliorer le rendement des cultures mais qui ne sont pas naturellement présents dans les sols) et d’importantes surfaces. Mais c’est aussi un modèle dans lequel les richesses et pouvoirs sont détenus par un petit nombre d’acteurs, au détriment de millions de petits producteurs. C’est pourquoi il peut être considéré comme responsable d’importants déséquilibres sociaux et dérèglements environnementaux, qui touchent en premier lieu les populations les plus vulnérables. Le système alimentaire agro-industriel émet à lui seul ⅓ des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Face à ces enjeux, la transition agroécologique peut être une solution. De plus en plus présente dans les débats scientifiques, agricoles et politiques internationaux, l’agroécologie propose une véritable alternative sociétale grâce à des systèmes agricoles et alimentaires durables, qui s’appuient sur une science des écosystèmes agricoles tirée des lois de la nature et des savoir-faire paysans. C’est un modèle qui vise à répondre aux besoins alimentaires des consommateurs et des marchés locaux, et qui se fonde sur une utilisation responsable et optimale des ressources naturelles, tout en respectant les valeurs sociales et humaines. Ainsi, l’agroécologie est un outil de résilience au changement climatique, puisqu’elle permet de réduire l’impact environnemental et climatique de notre agriculture et notre alimentaire et facilite l’adaptation du système agricole aux perturbations liées aux changements climatiques.
Dans ce sens, Xavier Reboud, chercheur en agroécologie à l’Inrae, explique qu’il existe un ensemble de leviers qui peuvent, conjointement, renforcer la régulation naturelle des bioagresseurs, et ainsi rendre nos systèmes agricoles moins vulnérables, sans user de pesticides. Le premier levier consiste à diversifier les plantes, mélanger les espèces et variétés, à l’échelle d’une parcelle. Le deuxième levier repose sur un sol en bonne santé. Les apports organiques présents dans un sol peu travaillé réduit son oxydation et favorise son activité biologique. Enfin, le troisième levier consiste à cultiver chaque parcelle sur une surface réduite tout en y combinant des infrastructures biologiques comme des haies ou des prairies. La combinaison de ces trois leviers formerait des agro-écosystèmes, qui permettraient non seulement de rendre les plantes moins vulnérables face aux bioagresseurs souterrains et aériens, mais aussi de renforcer leur résistance au stress lié aux évènements climatiques extrêmes.
Bien qu’à une échelle très réduite et largement subventionnée par l’aide internationale, l’agroécologie est mise à profit au Liban par des agriculteurs et activistes pour répondre à l’explosion de la pauvreté et à l’inflation. Aucun produit chimique n’est utilisé, les semences collectées dans le monde entier sont réutilisées chaque année et cultivées en harmonie avec la nature. Si la prise de conscience environnementale reste limitée selon les activistes, les libanais se tournent de plus en plus vers ces produits locaux, car leurs prix ont très peu augmenté depuis le début de la crise, contrairement aux produits importés. En outre, ils espèrent diffuser le savoir en matière de techniques agroécologiques auprès des agriculteurs pour mener le pays vers l’autosuffisance.
En Afrique, l’agroécologie est de plus en plus reconnue. Initialement développée sur le continent pour répondre à la demande croissante des consommateurs du Nord, elle devient un enjeu de taille pour la santé publique, l’autonomie alimentaire et le retour à la terre. L’agroécologie correspond en Afrique à un retour à l’agriculture traditionnelle, cependant il reste nécessaire de convaincre les jeunes agriculteurs de faire leur transition. Pour cela, de plus en plus d’initiatives sont menées, notamment de la part d’associations qui tentent de sensibiliser et former les consommateurs et les agriculteurs. En Guinée, la création d’un label bio est à l’étude, ce qui permettrait de garantir une rémunération juste aux producteurs, tout en encourageant un large public à acheter ces produits. Pour Leonida Odongo, éducatrice communautaire et militante pour la justice alimentaire à Nairobi, “l’avenir sera agroécologique ou ne sera pas”. En raison, selon elle, de la faiblesse des systèmes législatifs en Afrique, de nombreux pesticides interdits dans le monde continuent d’être utilisés par des agriculteurs grandement incités par les entreprises agroalimentaires. C’est pourquoi elle s’engage dans la sensibilisation et l’éducation d’agriculteurs kényans à des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement. Lors de sessions communautaires de formation, elle invite les agriculteurs à la réflexion et au partage de leurs expériences et connaissances transgénérationnelles, pour montrer que les formes de production autochtones et agro écologiques, tout en ne mettant pas en danger la biodiversité et la santé, sont tout aussi efficaces et rentables.
En France de plus en plus de fermiers et agriculteurs pratiquent l’agroécologie, comme Jérôme Orvain, fermier limousin. Il a d’abord choisi de privilégier les circuits courts, pour faire profiter ses productions à une économie locale, territoriale, plutôt que mondiale. Puis il a adopté l’agriculture biologique. Il explique aujourd’hui que ses produits sont “à 100% en vente directe, en circuit court et en bio”. C’est aussi le cas de Julien Piron, qui produit des légumes en maraîchage biologique et agroécologique, en Indre et Loire. Ancien chercheur en biologie humaine et animale à l’INSERM, il a choisi, il y a huit ans, d’acheter une prairie délaissée, pour en faire le Jardin d’Édaphon. L’édaphon désigne l’ensemble des organismes vivant dans le sol (vers de terres, bactéries, champignons…) qui s’installent et pérennisent, pendant et entre les cultures, lorsque la terre est très peu travaillée, permettant d’éviter l’utilisation d’intrants.
Cependant, la transition agroécologique nécessite une véritable volonté politique. Si les Etats qui saisissent l’importance de changer de modèle agricole et de modifier nos habitudes alimentaires sont de plus en plus nombreux, rares sont ceux qui initient un vrai changement. Ainsi, l’agroécologie reste largement sous-financée et reléguée au second plan, alors que des accords et politiques commerciaux écocides et inéquitables continuent à être signés et menés à tout va. Si même les Etats conscients de l’urgence se montrent aussi peu déterminés à produire de véritables changements, c’est qu’ils savent aussi que l’agroécologie n’est pas compatible avec le mode de production capitaliste. En effet, alors que la première repose sur des exploitations familiales durables et diversifiées qui nécessitent plusieurs années pour porter ses fruits, la seconde cherche, par des moyens techniques, à obtenir des profits immédiats. De plus, la première favorise une grande diversification des milieux, des espèces et des variétés ainsi que des habitats pour la faune et la flore, alors que la seconde mise sur l’ultra spécialisation des exploitations. Enfin, la première privilégie l’observation de la nature, l’adaptation permanente des pratiques aux évolutions de l’environnement, le contact entre l’humain, la terre et l’animal, alors que la seconde est fondée sur la rationalisation, la planification et la division du travail.
Par ailleurs, la transition agroécologique génère des coûts importants dans l’immédiat, d’autant plus que seule l’agriculture biologique bénéficie d’une aide spécifique au changement de système, relève France Stratégie dans un rapport publié en août 2020 sur les performances économiques et environnementales de l’agroécologie. Cependant, l’agroécologie s’avère rentable à moyen terme. Les bénéfices économiques proviendraient principalement de la réduction des charges liées à l’achat et à l’utilisation d’engrais et produits phytosanitaires de synthèse, ainsi que des prix de commercialisation plus élevés.
Les solutions proposées par la nouvelle réforme de la PAC pour concilier impératifs environnementaux et priorités socio-économiques divisent
Le 25 juin 2021, un nouvel accord a été conclu à Bruxelles entre les eurodéputés et les États membres de l’Union européenne sur la Réforme de la Politique agricole commune (PAC). Trois ambitions principales pour 2023-2027 : accroître le soutien des petites et moyennes exploitations agricoles, renforcer la transparence sur les dépenses des fonds européens et “verdir” l’agriculture européenne. Pour ce dernier point, les écorégimes, primes destinées aux agriculteurs adoptant des programmes environnementaux exigeants définis par chaque Etat selon des critères communs, sont notamment concernés. L’accord prévoit de consacrer en moyenne 25% (les eurodéputés réclamaient 30%) par an des paiements directs aux éco- régimes.
Du côté des eurodéputés Verts et des ONG environnementales, nombreux estiment cette réforme insuffisante. Pour l’eurodéputé Benoît Biteau, elle serait même “climatiquement nuisible et dangereuse pour la diversité”. Plusieurs points sont dénoncés, et parmi eux le nombre croissant de dérogations, notamment sur le conditionnement des versements au respect des normes sociales protégeant les travailleurs, ou sur le pourcentage de terres à ne pas cultiver et la rotation annuelle des cultures, qui sont des mesures clés pour la préservation de la biodiversité. Les politiques agricoles sont jugées incompatibles avec les objectifs environnementaux et climatiques de l’UE qui avaient été fixés par la Commission à travers le Pacte Vert, ne permettant pas de rendre plus durable le système alimentaire européen. Pour Benoît Biteau, “les écorégimes continuent d’utiliser comme références les hectares ou les têtes de bétail”, et encouragent ainsi les grandes exploitations et l’agriculture productiviste, au détriment des petites et moyennes exploitations agroécologiques. Par ailleurs, les objectifs de la Commission visant notamment une baisse à 50 % de l’usage des pesticides d’ici à 2030 et un quart des terres réservées au bio ne seront, selon lui, pas atteints, puisque ils ne sont pas “juridiquement contraignants”.
Alors qu’une personne sur trois se trouve en situation d’insécurité alimentaire à l’échelle mondiale et face au dérèglement climatique, il est essentiel de transformer notre système alimentaire actuel, basé sur l’agro-industrie et de soutenir les solutions permettant la résilience alimentaire.