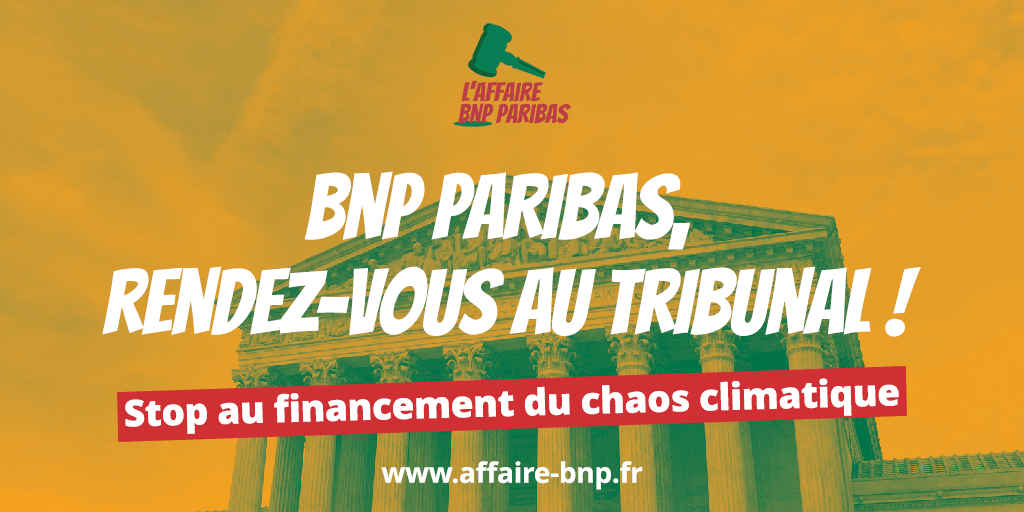| Depuis plusieurs mois de nombreux.ses acteur.ices se mobilisent pour demander une révision du règlement européen (REACH) qui encadre les substances chimiques les plus dangereuses. Prévue par la Commission elle-même dans une feuille de route publiée il y a déjà un an, cette révision est sans cesse repoussée sous la pression des lobbies. Cette révision permettrait notamment de prendre en compte les dernières études et actualités concernant les PFAS, ces « polluants éternels », particulièrement présents dans la vallée du Rhône. L’exposition à ces substances est associée à de nombreuses pathologies telles que des cancers, des troubles du système immunitaire ou du métabolisme comme l’obésité. Avec une coalition d’acteurs, Notre Affaire à Tous interpelle la Première Ministre sur l’importance d’une mobilisation de la France pour permettre de lever rapidement ce blocage très inquiétant et s’alarme de la position du commissaire au marché intérieur Thierry Breton sur ce sujet. |
Le 18 avril 2023,
Objet : 38 organisations vous interpellent pour une publication de la révision de REACH sans plus de retard
Madame la Première ministre,
Nos organisations s’inquiètent fortement du retard de la révision du règlement européen sur les produits chimiques, REACH, et de la position du commissaire au marché intérieur Thierry Breton sur ce sujet.
Le gouvernement français a exprimé son soutien en faveur d’une révision rapide du règlement REACH par les voix de Madame la Secrétaire d’Etat Bérangère Couillard [1] et de Monsieur le Ministre délégué Gabriel Attal [2], ainsi que dans une lettre adressée à la Commission Européenne [3]. Des commissaires européens [4][5] et des eurodéputés de la gauche à la droite sont engagés en faveur d’une révision rapide [5].
Cependant, au regard d’informations récentes [6], nous sommes inquiets de voir que le commissaire Breton semble déterminé à retarder, voire à supprimer la révision.
Si elle était confirmée, la position du commissaire français serait alors en rupture avec la position de votre gouvernement, ce qui nous interroge. Un tel blocage serait totalement incohérent avec d’une part l’ambition française pour l’Europe de développer une économie innovante et verte, soutenant les industries pionnières et progressives, d’autre part avec le plan industrie verte récemment initié par le Ministère de l’Economie.
Il y a pourtant urgence sanitaire et environnementale : 90% des citoyens français s’inquiètent de l’impact des produits chimiques sur leur santé et l’environnement [7], à raison. La pollution du territoire français aux « polluants chimiques éternels » (PFAS) a atteint un niveau sans précédent [8]. Chaque nouveau rapport démontre la présence de substances nocives dans nos produits de consommation quotidiens [9] telles que des perturbateurs endocriniens [10], des nanoparticules [11] et autres substances toxiques pour la reproduction [12]. Vous le savez, l’exposition à ces substances est associée à de nombreuses pathologies telles que des cancers, des troubles du système immunitaire ou du métabolisme comme l’obésité [13]. Le tout engendre des coûts de santé publique considérables [14]. Ces substances contaminent nos sols, notre eau, notre air et notre nourriture [15]. Cette pollution s’est développée alors que REACH était en place.
Les entreprises appellent de leurs vœux cette réforme, notamment les représentants de l’industrie chimique européenne (Cefic), afin d’assurer davantage de prédictibilité [16] et de garantir des investissements sûrs à long terme. Des marques européennes phares (IKEA, Décathlon, Adidas, etc.) [17], des mutuelles françaises [14] et 200 médecins et chercheurs en toxicologie français [18] appellent à présenter la révision sans délai. Des investisseurs [19] demandent aux entreprises chimiques d’éviter des investissements risqués, par exemple dans les polluants chimiques éternels. Cela démontre que le secteur privé aspire à une production chimique sûre et durable pour rester compétitif sur le long terme. Les entreprises ont besoin d’un cadre juridique clair : elles doivent savoir aujourd’hui dans quelle direction s’engager pour la décennie.
Si la révision de REACH n’est pas présentée avant l’été, cela entraînera un retard important en raison du calendrier institutionnel européen. Chaque semaine de délai alimente des niveaux toujours plus élevés de pollution toxique et alourdit les coûts de santé et ceux liés à la contamination de notre environnement. Si vous n’agissez pas en faveur d’une révision rapide, la France portera sa part de responsabilité.
C’est pourquoi nous vous demandons, Madame la Première Ministre, de faire valoir une position française claire, forte et ambitieuse auprès de la Commission européenne, et notamment auprès du commissaire Thierry Breton, afin de finaliser au plus vite cette réforme.
Dans l’attente de l’intervention de votre gouvernement sur ce dossier urgent, nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous au plus tôt et vous prions d’agréer, madame la Première Ministre, l’expression de notre très haute considération.
Références:
[1] Conseil des Ministres de l’Environnement, 20 décembre 2022, intervention de la France
[2] Lettre du Ministre délégué Gabriel Attal sur la révision de REACH, 27 mars 2023
[3] Lettre de huit États-membres européens y compris la France, demandant une révision rapide du règlement REACH, 4 octobre 2022
[4] Événement du groupe Renew au Parlement européen, 9 mars 2023, Séminaire sur l’innovation verte dans la chimie à travers REACH, intervention du Commissaire Sinkevičius et d’eurodéputés
[5] Le Monde, 25 novembre 2022, interview avec le vice-président de la Commission Timmermans
[6] Contexte, 21 octobre 2022, Qui a tiré sur Reach ? ; Mediapart, 5 avril 2023, Produits chimiques : Thierry Breton a tenté de torpiller le nouveau règlement européen ; Le Monde, 19 octobre 2022, « Les lobbys de l’industrie chimique ont gagné » : la Commission européenne enterre le plan d’interdiction des substances toxiques pour la santé et l’environnement
[7] Eurostat, mars 2020, Eurobaromètre
[8] Le Monde, 23 février 2023, « Polluants éternels » : explorez la carte d’Europe de la contamination par les PFAS
[9] BEUC, 13 mars 2023, Worrying number of dangerous products reaching consumers highlights need for greater action by authorities
[10] Endocrine Society, Common EDCs and Where They Are Found
[11] AVICENN, décembre 2022, En quête de nanos dans les produits du quotidien
[12] The Guardian, 28 mars 2021, Shanna Swan: ‘Most couples may have to use assisted reproduction by 2045’
[13] Agence européenne pour l’environnement, mars 2023, Chemicals and health
[14] Le Monde, 8 avril 2023, Pollution : « La réglementation européenne sur les substances chimiques doit être révisée d’urgence »
[15] The Guardian, 18 janvier 2022, Chemical pollution has passed safe limit for humanity, say scientists ; Générations futures, 12 janvier 2023, État des lieux de la présence de composés perfluorés dans les eaux de surface en France ; CHEM Trust, décembre 2022, Les substances chimiques nocives dans les matériaux entrant en contact avec les aliments en France
[16] CHEM Trust et EEB, 15 mars 2023, Waiting for REACH, p. 4, citation du Cefic
[17] ChemSec, 15 décembre 2022, A company request for an ambitious revision of REACH
[18] Le Monde, 6 décembre 2022, tribune, « Le report du plan européen d’interdiction des substances toxiques traduit la pression des lobbys industriels»
[19] ChemSec, 29 novembre 2022, Investors with $8 trillion call for phase-out of dangerous “forever chemicals”