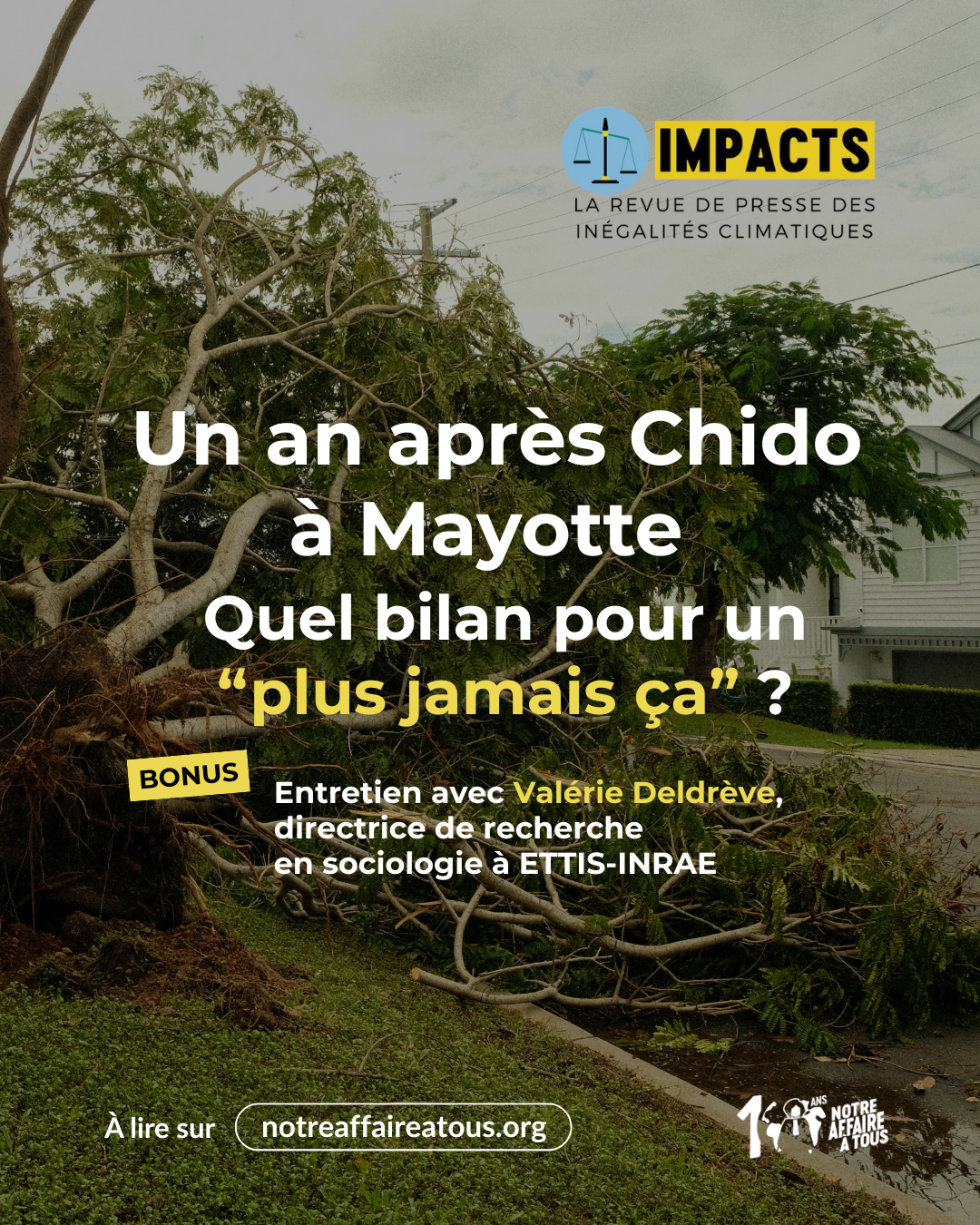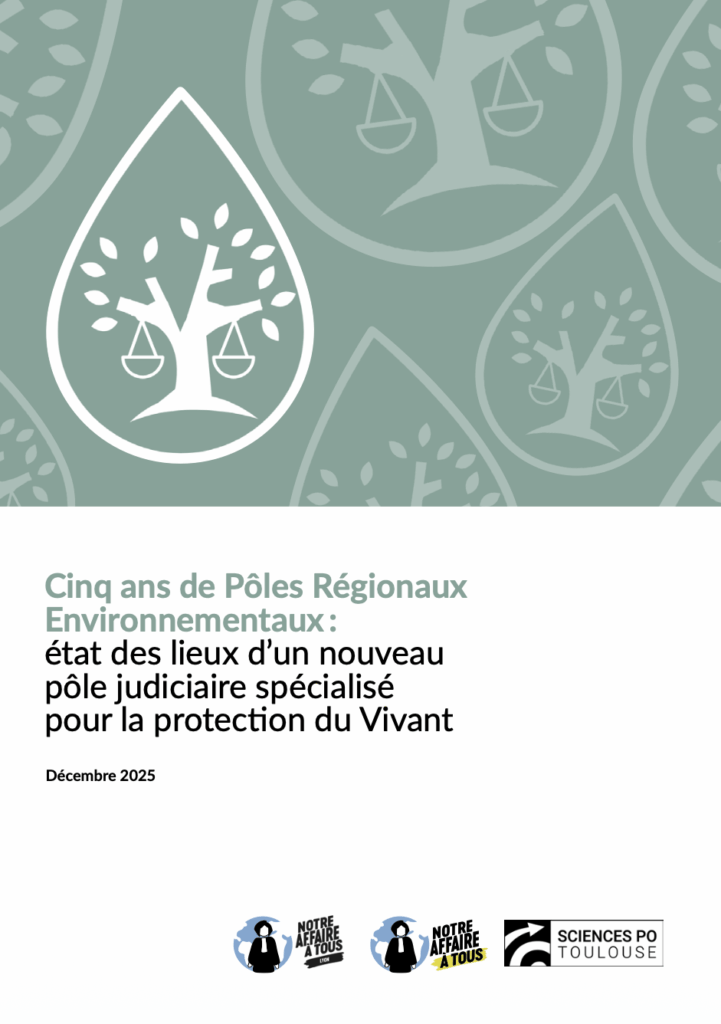Communiqué de presse, Paris, le 18 février – Dans le contentieux climatique engagé par Notre Affaire à Tous, Sherpa, France Nature Environnement, ZEA et la ville de Paris contre TotalEnergies, une audience cruciale se tient les 19 et 20 février au Tribunal judiciaire de Paris. Il s’agit du premier contentieux climatique en France visant à contraindre une multinationale pétrolière à cesser sa contribution à l’aggravation du changement climatique.
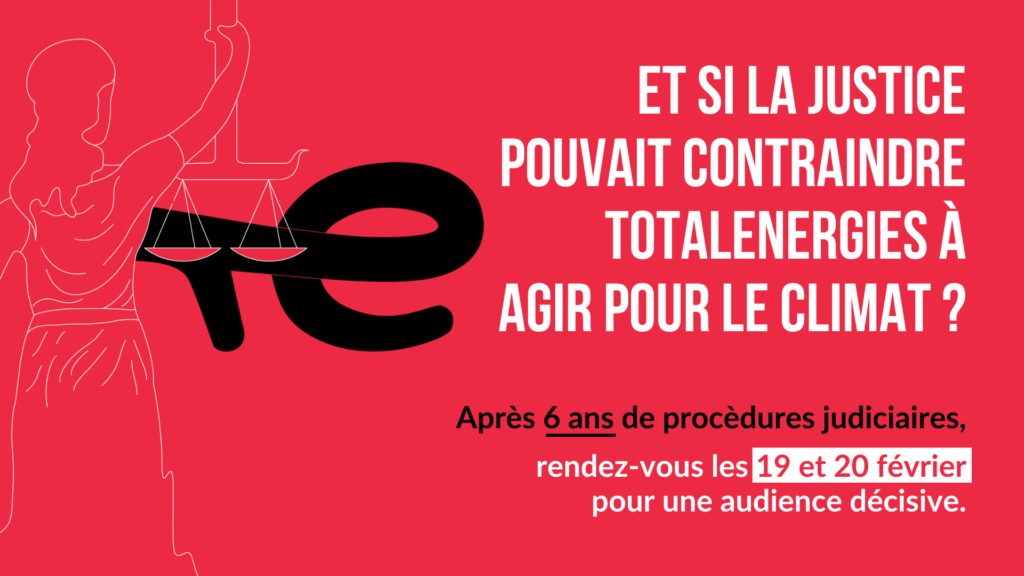
En janvier 2020, une coalition d’associations et de collectivités (1) a assigné TotalEnergies en justice. L’objectif est de contraindre la compagnie pétrolière à prendre les mesures nécessaires pour s’aligner avec l’objectif 1,5°C de l’Accord de Paris, conformément à la loi sur le devoir de vigilance.
Après six longues années de procédure, retardée par la stratégie dilatoire de TotalEnergies, une audience déterminante se tient enfin sur le fond de l’affaire. Cette audience permettra de débattre des risques climatiques résultant des activités du groupe pétro-gazier et d’évaluer si les mesures mises en place pour les prévenir sont adaptées. Des membres du GIEC, Valérie Masson-Delmotte et Céline Guivarch, seront également entendues par les juges.
Une stratégie d’expansion fossile incompatible avec le respect des objectifs de l’Accord de Paris
Le groupe se présente comme un “acteur majeur de la transition énergétique” et affiche son “ambition” d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Déjà condamné en octobre 2025 pour greenwashing, TotalEnergies continue pourtant de fonder sa stratégie et son modèle économique sur le développement des énergies fossiles.
L’entreprise fait partie des 20 plus grands émetteurs historiques de gaz à effet de serre et des 10 majors pétro-gazières (2). Loin d’engager une réduction de sa production d’hydrocarbures, TotalEnergies prévoit au contraire de l’augmenter à hauteur de 3% par an, en maintenant a minima ⅔ de ses investissements dans les énergies fossiles jusqu’en 2030 (3). Elle est liée au plus grand nombre de nouveaux projets d’énergies fossiles dans le monde – dont au moins 30 « bombes carbones » (4) représentant à elles seules 70 milliards de tonnes équivalent CO2 – soit plus de la moitié du budget carbone mondial restant pour limiter le réchauffement à 1,5 °C. Pourtant, selon le consensus scientifique (5), aucun nouveau projet d’énergie fossile ne devrait voir le jour pour respecter les objectifs de l’Accord de Paris, c’est-à-dire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.
Face à l’inaction de l’entreprise, la justice est saisie pour la contraindre à respecter ses obligations climatiques
Adoptée en 2017, la loi sur le devoir de vigilance impose aux grandes entreprises françaises d’identifier les risques et de prévenir les atteintes aux droits humains et à l’environnement résultant de leurs activités et de celles de leurs filiales. Avec cette action, c’est la première fois que les juges sont appelés à se prononcer sur l’application du devoir de vigilance en matière climatique.
La coalition se fonde également sur l’article 1252 du Code civil, qui permet à toute personne ayant intérêt à agir de saisir la justice afin de prévenir un dommage à l’environnement.
Les enjeux sont majeurs : le Tribunal pourrait contraindre l’entreprise, le cas échéant sous astreinte financière, à réduire rapidement ses émissions sur l’ensemble de ses activités (l’exploration, l’extraction, la production et l’utilisation de ses produits) et à adopter les mesures nécessaires, telles que la cessation de nouveaux projets pétroliers et gaziers.
Un mouvement mondial pour mettre fin à l’impunité des carbon majors
Face aux attaques ciblant actuellement les normes environnementales et sociales, il apparaît indispensable de poursuivre et de renforcer la lutte en faveur de la transition climatique. Cette action s’inscrit dans un mouvement international de contentieux climatiques visant à faire reconnaître la responsabilité des grandes entreprises fortement émettrices – les carbon majors – pour leur contribution majeure au dérèglement climatique, à l’instar de l’affaire Shell aux Pays-Bas.
“Cette affaire rappelle que la justice a un rôle clé à jouer pour garantir l’effectivité du devoir de vigilance et exiger des multinationales pétrolières, telles que TotalEnergies, qu’elles contribuent à la réalisation des objectifs de l’Accord de Paris” – NAAT, Sherpa et France Nature Environnement
“La pollution de l’air tue encore à Paris, à cause notamment des industries fossiles comme Total. Depuis 2014 nous avons fait baisser la pollution de l’air de 50% et nous investissons fortement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Il est temps que ces entreprises soient mises face à leurs responsabilités.” – Anne Hidalgo, Maire de Paris.
Notes
(1) La coalition initiale regroupait initialement 5 associations et 14 collectivités territoriales. Seule la Ville de Paris a été reconnue ayant un intérêt à agir.
(2) The Carbon Majors Database.
(3) TotalEnergies, communiqué de presse, Septembre 2025.
(4) Site internet du consortium CarbonBombs.org – Profil de TOTALENERGIES.
(5) IEA, Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach, 2023 Update 2023; IPCC, Summary for Policymakers, Climate Change 2023: Synthesis Report 2023.
Contacts presse
Sherpa – Chloé Guérif : presse@asso-sherpa.org
Notre Affaire à Tous – Justine Ripoll : justine.ripoll@notreaffaireatous.org
France Nature Environnement – Eloi Pérignon : eloi.perignon@fne.asso.fr
Ville de Paris : presse@paris.fr