Communiqué de presse, Paris, le 17 juin 2025 – Une vingtaine d’associations et syndicats ont mené aujourd’hui une action place de Breteuil à Paris pour dénoncer la vague de dérégulation environnementale et sociale en cours en Europe, notamment via la directive « Omnibus I » actuellement en négociation au niveau du Conseil de l’UE et du Parlement européen. Ils alertent sur la position du gouvernement français et exigent que la voix de la société civile et l’avis des Français·es soient entendus.

À l’image des politiques brutales du président américain Donald Trump, la Commission européenne attaque les obligations des entreprises en matière de respect des droits humains, du climat et de l’environnement, avec sa proposition de directive « Omnibus I ». Présentée en février 2025, elle propose de revenir sur des directives phares adoptées récemment sur le devoir de vigilance des entreprises (CSDDD) et sur la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises (CSRD).
Face au silence opposé à leurs demandes de rendez-vous auprès de l’Elysée et de Matignon (1), une large coalition d’organisations a dénoncé aujourd’hui un scandale démocratique européen et français aux conséquences catastrophiques, à travers une mise en scène satirique de
manifestant·e·s pro-dérégulation demandant par exemple le rétablissement du travail forcé et de la déforestation, tandis qu’une parodie d’Emmanuel Macron inaugurait la « Place de la simplification ».
La France avait pourtant été pionnière en 2017 en adoptant sa loi sur le devoir de vigilance, saluée comme une avancée historique pour les droits humains et l’environnement. Cependant, la France retourne sa veste et tourne le dos à la société civile, aux victimes de violations de droits humains et à une partie des acteurs économiques français, en s’alignant avec les lobbys.
Reprenant les demandes de l’extrême droite souhaitant démanteler les avancées sociales et environnementales européennes, Emmanuel Macron annonçait le 19 mai, lors du sommet Choose France, vouloir aller plus loin encore que la directive « Omnibus I » et supprimer définitivement la CSDDD (2).
Ce revirement s’inscrit dans un élan inquiétant en France, où les normes sociales et environnementales sont attaquées sous couvert de « simplification » (3). Le gouvernement s’enfonce ainsi dans une tendance qui va à l’encontre des préoccupations des Français·es qui, sondé·e·s par OpinionWay pour Reclaim Finance et le Forum citoyen pour la justice économique début juin 2025, se sont prononcé·e·s à plus de 80 % en faveur de l’obligation pour les multinationales de respecter le climat et les droits humains, y compris parmi les sympathisant·e·s de la majorité présidentielle et LR.
Au niveau européen, la directive « Omnibus I » est une des premières pierres posées sur la voie d’une dérégulation massive risquant de balayer les avancées du Pacte Vert (4). Les associations s’alarment d’autant plus qu’une enquête a été ouverte par la médiatrice de l’Union européenne suite à une plainte de 8 associations, condamnant le caractère non démocratique, opaque et précipité du processus de l’« Omnibus I ». La médiatrice donnera ses conclusions le 18 juin 2025.
La Commission européenne et le gouvernement français nous emmènent donc sur une voie où tout le monde perdra : les populations du Sud global, les peuples autochtones, les travailleur·euse·s ici et là-bas, les syndicats, les citoyen·ne·s européen·ne·s, les femmes et les minorités de genre, l’environnement et le climat, les finances publiques, et les entreprises elles-mêmes.
Le Conseil de l’UE finalise actuellement sa position et le Parlement européen démarre l’examen du texte. Il n’est pas trop tard pour que nos organisations soient entendues et pour faire cesser ces attaques contre les droits humains, l’environnement et le climat.
Nous demandons notamment de :
- Maintenir l’obligation de devoir de vigilance au-delà des partenaires directs des entreprises pour couvrir toute leur chaîne de valeur ;
- Conserver la consultation de toutes les parties prenantes et veiller à ce que leur engagement soit central tout au long du processus du devoir de vigilance ;
- Conserver la possibilité d’engager la responsabilité civile d’une entreprise en cas de manquement aux obligations prévues par la directive ;
- Conserver l’obligation pour les entreprises de mettre en oeuvre leurs plans de transition climatique ;
- De soutenir l’inclusion à terme des services financiers dans le devoir de vigilance européen.
Les détails de nos recommandations sont à consulter ici.
Contact presse
Justine Ripoll, responsable de campagnes : justine.ripoll@notreaffaireatous.org
Notes
(1) Certaines de nos organisations ont envoyé des courriers au Président et au Premier ministre en janvier et en avril 2025, mais n’ont pas reçu de réponse à ce jour, malgré de très nombreuses relances.
(2) Nos organisations ont condamné l’annonce du Président Emmanuel Macron le 20 mai 2025 dans un communiqué de presse commun.
(3) Notamment récemment à travers le projet de loi de simplification de la vie économique voté ce mardi 17 juin à l’Assemblée nationale et la proposition de loi visant à lever les contraintes du métier d’agriculteur.
(4) Notamment le report du règlement contre la déforestation, la révision de la politique agroalimentaire, la révision du règlement concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, etc.
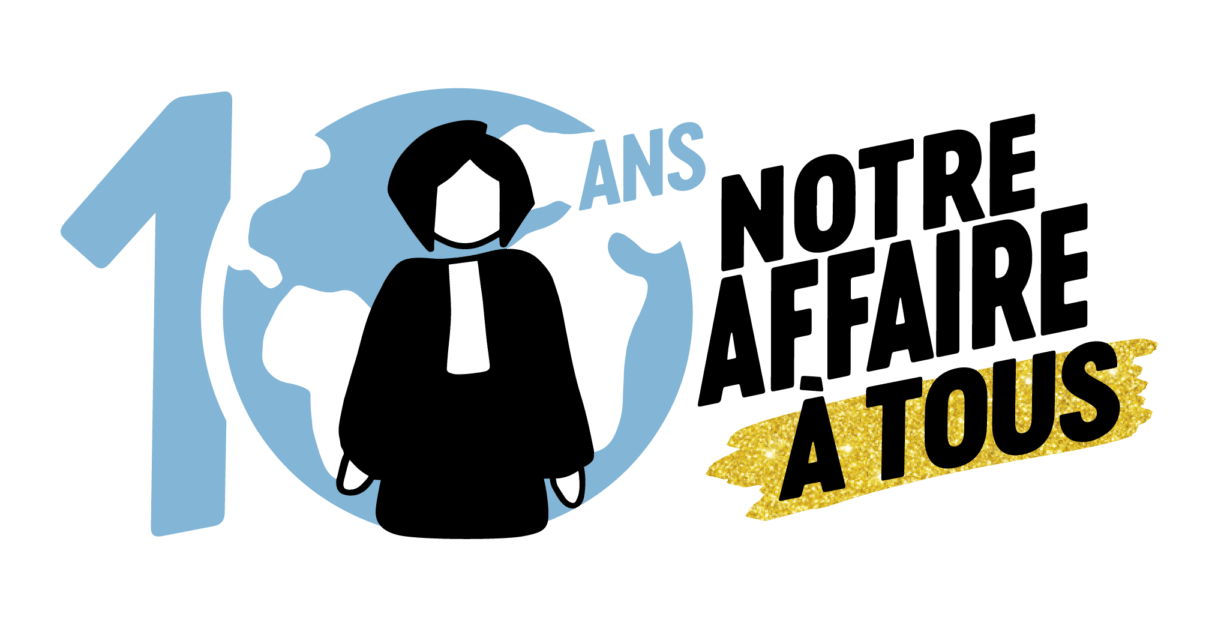

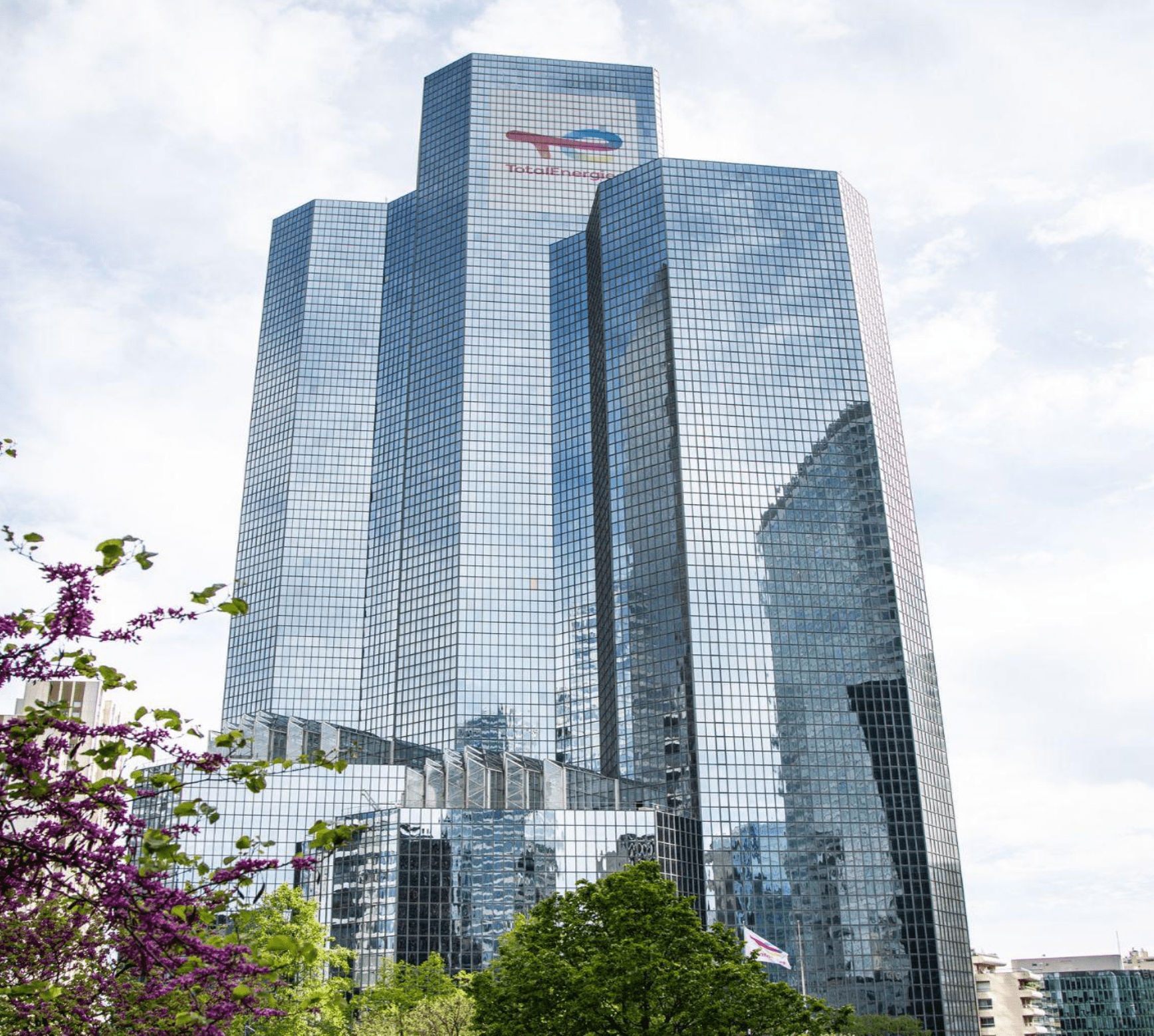


![[Tribune] “ Il est urgent de réformer les protocoles d’évaluation des pesticides par l’ANSES ”](https://notreaffaireatous.org/wp-content/uploads/2025/05/Screenshot-2025-05-05-at-10-36-22-Banniere-JPLV-1920-px-×-250-px-Canva.png)


