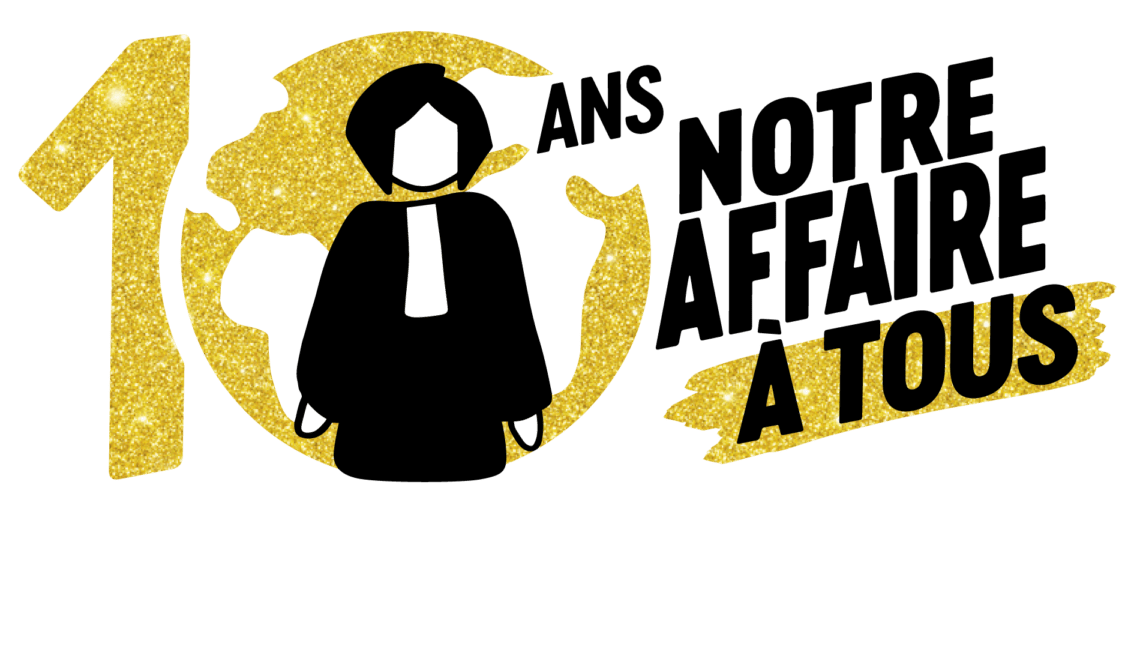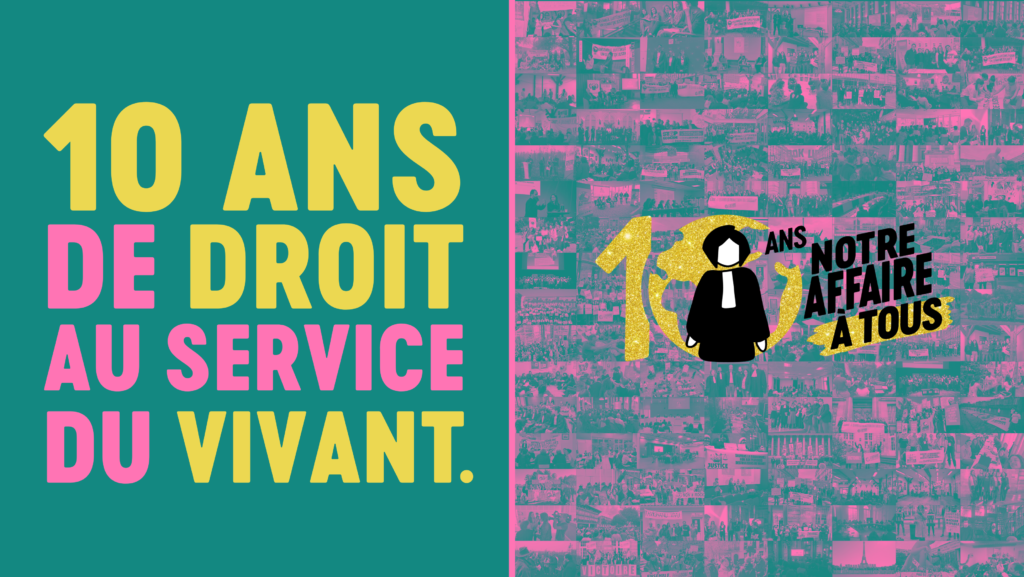Communiqué de presse, Paris, 9 décembre 2025 – Les représentant·e·s des États membres de l’Union européenne et du Parlement européen ont trouvé cette nuit un accord sur l’Omnibus I, une directive destinée à affaiblir le devoir de vigilance européen (CSDDD). À la suite d’une alliance historique entre droite et extrême droite au Parlement européen, et confrontés à des ingérences étrangères (États-Unis, Qatar…) et industrielles incessantes, les États membres et la Commission ont fait le choix de la capitulation. Le compromis trouvé éloigne fatalement la CSDDD de son objectif : prévenir et réparer les atteintes aux droits humains et à l’environnement commises par les multinationales. L’accord politique doit désormais être formellement voté par le Conseil et le Parlement européen dans les prochains jours.

Le cocktail était explosif : de nombreux acteurs alertaient sur les reculs envisagés par l’Omnibus I, l’irrégularité de la procédure législative engagée, un lobbying agressif contre les textes du Pacte Vert, et l’alliance politique historique de la droite européenne avec l’extrême droite contre ce texte. Le Conseil de l’UE et le Parlement européen auraient pu résister tout le long du processus législatif. Las, cette nuit, les États membres et le Parlement se sont mis d’accord pour démanteler le devoir de vigilance européen :
- Le compromis acte le relèvement des seuils d’application du devoir de vigilance européen afin que ce dernier ne s’applique qu’aux sociétés de plus de 5 000 salarié·e·s et réalisant plus d’1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires. Le nombre de sociétés concernées s’en trouverait réduit à peau de chagrin.
- Le compromis entérine la suppression pure et simple du volet climatique de la directive sur le devoir de vigilance européen. L’extrême droite européenne et les lobbies ont obtenu que les entreprises n’aient plus pour obligation d’adopter des plans de transition climatique visant à garantir la compatibilité de leur modèle et de leur stratégie économiques avec les objectifs de l’Accord de Paris.
- Le compromis n’épargne pas la responsabilité civile, pilier fondamental du devoir de vigilance. Très loin d’une simplification, le compromis acte le fait de ne plus harmoniser le régime de responsabilité civile, conduisant à une fragmentation des régimes juridiques selon les États membres, au détriment à la fois des victimes et des entreprises.
- Enfin, le délai pour la transposition est à nouveau repoussé d’un an, à juillet 2028. Les nouvelles obligations ne s’appliqueront aux entreprises qu’à partir de juillet 2029. A nouveau les multinationales gagnent du temps.
Ces reculs auront des effets néfastes très concrets pour les personnes affectées par les activités des multinationales, en Europe et ailleurs.
Au-delà de ses impacts environnementaux et sociaux, l’issue de ce trilogue marque un tournant historique : les institutions européennes ont rompu le cordon sanitaire et accepté que l’extrême-droite et les lobbies européens mais aussi étrangers tiennent la plume pour légiférer en Europe.
Il s’agit du premier texte de dérégulation d’une série annoncée par la Commission européenne, présageant du pire pour l’avenir du droit européen.
Face à ces avancées funestes, nos organisations appellent la France à se montrer à la hauteur des enjeux et de ses engagements passés en refusant fermement ce compromis réactionnaire.
Contacts presse
ActionAid France – Chloé Rousset – chloe.rousset@actionaid.org
Amis de la Terre France – Marcellin Jehl : marcellin.jehl@amisdelaterre.org
BLOOM – Pauline Bricault : paulinebricault@bloomassociation.org
CCFD-Terre solidaire – Sophie Rebours : s.rebours@ccfd-terresolidaire.org
Notre Affaire à Tous – Justine Ripoll : justine.ripoll@notreaffaireatous.org
Oxfam France – Lea Guerin : lguerin@oxfamfrance.org
Reclaim Finance – Olivier Guérin : olivier@reclaimfinance.org
Sherpa – Lucie Chatelain : lucie.chatelain@asso-sherpa.org